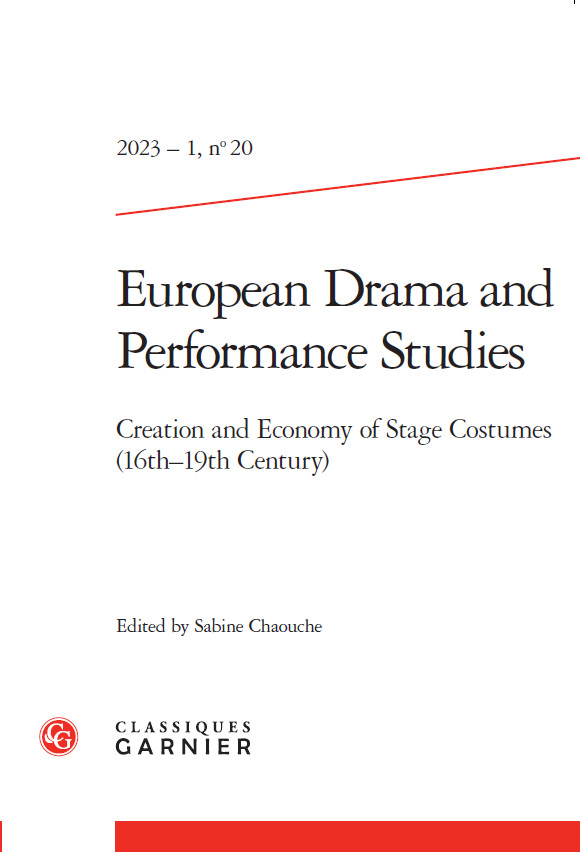" Il ne s’agit pas de s’écrier sans cesse : le génie seul suffit sur la scène, l’art de représenter ne s’acquiert point par étude ; le Théâtre est le tableau du monde ; il n’y faut suivre absolument que la simple nature : l’assujettir à des règles, c’est lui ravir tout son feu. Voilà des raisons générales qui ne prouvent rien ; il vaudrait mieux convenir que le vrai talent est de cacher l’art qui soutient la nature, & qu’il y a bien plus d’art dans les choses, où l’art même paraît le moins. C’est ici que les extrémités se touchent ; l’art porté à son comble devient nature, & la nature négligée ressemble trop souvent à l’affectation " (1) .
Sticotti, évoque, à travers ces quelques lignes, certains lieux communs relatifs à l’idée de nature au théâtre. Selon certains de ses contemporains, l’art de l’acteur n’étant qu’un art de goût, il n’est pas nécessaire d’acquérir une formation avant de se lancer à la conquête du public. Cette pensée d’un jeu où le pur naturel structurerait la représentation est spécieuse et fallacieuse selon Sticotti car si la nature est bien sujet de représentation (le référent), le faire de l’acteur quant à lui, en tant qu’art, repose sur une technique que l’acteur sait néanmoins savamment faire disparaître. La vision des spectateurs est tronquée parce qu’extérieure. L’art reste imperceptible lorsqu’il est porté à sa perfection. Il se confond alors avec la nature car telle est sa finalité, telle est la loi de l’illusion. Toutefois le naturel ne peut être confondu avec l’art : la scène théâtrale a des impératifs particuliers qu’il s’agit de respecter afin de représenter « une idée juste de la belle nature (2) ». Cette idée de Jean-François Marmontel est reprise par Denis Diderot dans ses Observations sur une brochure intitulée Garrick ou les acteurs anglais en 1770. Le philosophe pense en effet l’Acteur en termes esthétiques. Le premier jet de ce qui deviendra le Paradoxe sur le comédien se veut une apologie de l’art contre le naturel, art qui est déterminé par une conception de la représentation fondée sur le Beau.
Pour Diderot la représentation théâtrale, ne peut jamais être totalement naturelle puisque l’art de l’acteur se veut imitation (mimèsis). D’où la remarque de Diderot : « Et comment la nature, sans l’art, formerait-elle un grand comédien, puisque rien ne se passe rigoureusement sur la scène comme en nature, et que les drames sont tous composés d’après un certain système de convention et de principes ? » (3) Le philosophe fait ici référence à la poétique théâtrale. L’auteur est tenu d’écrire une pièce selon des règles (de lieu, de temps, d’unité d’action, selon la bienséance etc...). Tout art de la représentation se fonde ainsi sur des conventions. Le jeu n’y échappe pas. Désirer un acteur entièrement naturel au théâtre semble donc incohérent et absurde puisque tout est fait, dans l’art théâtral, pour que les choses ne soient pas, précisément, naturelles. Il est donc indispensable que l’acteur acquière une technique. Le jeu repose lui aussi sur une esthétisation du réel par un travail de mise en forme, c’est-à-dire de poétisation (du personnage, du vrai, de la scène), qui suppose l’agrandissement. La scène est le lieu où la nature est amplifiée, où elle doit avoir une résonance plus forte – une nature présentée sous une forme hyperbolique en quelque sorte. Tous les penseurs s’accordent sur ce point :
" si l’on entend par jouer l’effet que les touches du tableau si j’ose m’exprimer ainsi ; soient mâles, vigoureuses, les tons tranchants, la voix pleine & forte, la diction énergique, la figure expressive ; il est facile de juger que sans cela, le jeu le plus vrai, la plus belle Nature ne fera que bien peu d’effet ; & si un Acteur s’avisait de parler à voix basse, & tel qu’un Roi dans son cabinet, ce qu’il ferait serait en pure perte : mais si le débit doit être plus expressif, plus mâle au Théâtre que dans la Société ; il n’en doit pas moins être naturel, & la raison en est simple ; la conversation du Théâtre ne diffère de celle de la Société qu’en ce que dans celle-ci, ceux qui écoutent sont à portée de distinguer l’Orateur de fort près, & qu’au Théâtre ils en sont plus éloignés : or, cette distance pourra bien favoriser, en quelque sorte, l’illusion, & faire supporter sur la Scène ce qui ne serait pas supportable en Société, & qu’on verrait clairement être faux ; mais cette même distance ne fera pas trouver, dans de simples sons, cette âme qui n’y sera vraiment pas " (4) .
Tournon souligne ici par exemple que le jeu doit être soutenu au théâtre mais doit rester naturel, c’est-à-dire en rapport avec l’objet de représentation : une tonalité de voix exagérément haute, inaudible, des inflexions dans le fausset, des mouvements trop faibles ou trop véhéments qui ne reflèteraient pas dans son exactitude le personnage et la situation paraîtraient ou outrés, ou impropres au théâtre. Si le théâtral est ainsi en soi une amplification, cela ne signifie pas pour autant qu’elle soit exagération déplacée – laquelle peut néanmoins exister dans le genre comique ou farcesque, mais il est alors question de théâtralité, et non plus de ce qui est propre, naturel au théâtre. Le jeu prend donc appui, dans sa constitution même, sur des règles qui mettent en scène cet agrandissement : le port plus élevé de la voix qui impose à l’acteur une projection du souffle, l’expressivité plus marquée des traits et du geste signalent un faire spécifiquement théâtral, qui se distingue du faire ordinaire. Marmontel suggérait ainsi dès 1753 que la déclamation, qu’elle soit comique ou tragique, se plie aux mêmes règles : « par la même raison qu’un tableau destiné à être vu de loin, doit être peint à grandes touches, le ton du théâtre doit être plus haut, le langage plus soutenu, la prononciation plus marquée que dans la société, où l’on se communique de plus près, mais toujours dans les proportions de la perspective, c’est-à-dire de manière que l’expression de la voix soit réduite au degré de la nature, lorsqu’elle parvient à l’oreille des spectateurs . » (5) Le thème de l’optique revient fréquemment dans les écrits sur l’art théâtral, avec notamment la mise en parallèle du fonctionnement du théâtre antique et du théâtre français de l’époque (6) , et il semble évident dans la seconde moitié du siècle que le dire et le faire au théâtre, pour s’accomplir, répondent à des exigences qui forcent, nécessairement l’acteur, à posséder une technique. Mais le grossissement du jeu varie d’une scène à l’autre. Ainsi l’acteur s’adapte constamment à l’enceinte dans laquelle se donne la représentation. Jean Mauduit dit Larive signale par exemple à la fin du siècle que l’immensité des théâtres nuit à la beauté du spectacle tant d’un point de vue gestuel, le jeu muet passant inaperçu pour le public le plus écarté de la scène, que d’un point de vue vocal :
" Une autre cause, qui n’a pas moins contribué à énerver les effets d’une diction pure, est celle qui tient à la grandeur démesurée de nos nouvelles salles, et à leur genre de construction. La perfection du talent des comédiens tient à la vérité ; la vérité ne veut que des moyens naturels, et l’on cesse d’être vrai, lorsque l’on est forcé de composer avec ses moyens ". (7)
L’unité de la sonorité, qui était maintenue pour lors dans les petits théâtres, est désormais brisée. La taille de la salle oblige l’acteur à amplifier sa voix au maximum afin que les derniers rangs puissent l’entendre correctement. Cette trop grande vastitude a des effets pervers : certes l’augmentation du volume de la voix apparaît agréable et obligatoire pour les spectateurs assez éloignés du plateau. Cela dit, les premiers rangs, ont quant à eux les oreilles déchirées par une sonorité trop élevée et véhémente. De plus, il n’est guère loisible, à tous les acteurs d’être parfaitement maîtres de la technique de projection de la voix. Certains se contraignent, et de fait, forcent leur voix qui devient criarde, puis de plus en plus altérée. L’acteur monte de plus en plus dans les aigus, d’où une fatigue croissante, une voix qui s’éraille et s’éteint. D’autres travestissent leur voix :
" Si la grandeur de la salle ne lui permet pas d’animer et d’échauffer le public dans les choses qui n’exigent que l’accent du sentiment et la vérité simple, il s’attache alors aux intonations fortes qui lui ont le plus réussi ; il les ramène sans cesse, et, par-là, tombe dans une monotonie qui devient, à la longue, fastidieuse et insoutenable. N’étant plus le maître de s’abandonner aux émotions qu’il éprouve, toujours en garde contre la faiblesse de ses moyens, lorsqu’il est vraiment ému, il est obligé de se souvenir que trois mille personnes, qui veulent l’entendre, ne lui feraient pas grâce d’un soupir s’il est étouffé. Quand l’acteur sacrifie l’accent sentimental de sa voix, tout est perdu pour le talent . "(8)
L’acteur, dans sa volonté de plaire au public tombe dans l’affectation. Il lui est impossible de conserver des accents naturels et variés, trop (pré)occupé qu’il est à être audible. La voix forcée perd de sa souplesse : l’acteur crie continûment au lieu de « parler », s’époumone en pure perte. Les inflexions qui font les délices des spectateurs, qui condensent le sentiment en de subtiles modulations disparaissent, laissant place à un long et uniforme râle déclamatoire. La beauté au théâtre naît ainsi, en premier lieu, d’une maîtrise technique.
Le théâtre de société est aussi dans sa représentation, radicalement différent de la Comédie-Française. L’anecdote de l’actrice remarquable dans un salon puis médiocre sur une scène publique d’un grand théâtre qui étaye la démonstration de Diderot (9) , exclut tout faire théâtral qui ne serait pas en adéquation avec la taille du lieu et de l’auditoire. L’espace de créativité, le cadre de jeu apparaît ainsi déterminant. Tout au théâtre est démesuré de sorte qu’il ne peut jamais y avoir de vrai naturel chez l’acteur (c’est un « naturel » de lieu et de circonstances). La technique sert à conférer au rôle une dimension supérieure afin qu’il fasse effet sur le spectateur. La notion d’élévation, de même que les rapports entre haut et bas sont alors capitaux dans l’esthétique du Beau artistique chez Diderot. Un théâtre qui serait présentation de la nature et non représentation de celle-ci nierait l’existence d’un art de l’acteur, l’illusion n’ayant plus aucune part dans le spectacle. Tout un chacun pourrait se proclamer acteur et aucune distinction ne pourrait être établie entre un simple néophyte et un génie. L’art, pour le coup, ne serait plus livré qu’au goût. C’est pourquoi un acteur-penseur comme Jean-Nicolas Servandoni d’Hannetaire, qui a des vues similaires à tous les théoriciens de l’époque ― la notion d’art n’étant jamais infirmée en soi mais simplement nuancée (le degré d’Art que l’acteur doit cultiver et appliquer) ―, insiste sur la nécessité d’avoir des règles structurant le jeu afin de délivrer l’art du jugement esthétique du spectateur et de cette croyance en un absolu naturel de l’acteur :
" Oh ! mais… La nature ! s’écrie-t-on sans cesse, n’écoutez, ne suivez que la nature… Car c’est là le refrain ordinaire qu’on semble répéter par écho, la nature !… Mais vraiment c’est ne rien dire ; on ne doute point qu’il ne faille suivre la nature, puisqu’elle est le principe général de tous les arts. Dites plutôt comment il faut s’y prendre pour la suivre, indiquez-en les vrais moyens, et cela vaudra mieux qu’un précepte vague, qui ne signifie presque rien, surtout aux yeux d’un Commençant " . (10)
S’il ne peut y avoir de règles pour juger du Beau – le jugement esthétique reposant intrinsèquement sur un goût arbitraire –, l’art doit néanmoins s’affirmer à travers l’idée de la belle représentation, laquelle ne peut concrètement se réaliser que par l’application d’un ensemble de conventions aptes à améliorer qualitativement le faire théâtral. La formation de l’acteur concourt à embellir la nature mais aussi l’art qui, dès lors, se survit en tant qu’art à part entière et spécifique au théâtre : en se perfectionnant, l’acteur non seulement assimile tous les acquis, autrement dit tous les codes existants, tous les préceptes qui se sont constitués a posteriori parce qu’ils ont été cautionnés par le temps (par exemple l’actio oratoire héritée de l’Antiquité), mais ne cesse de les amender, de les renouveler, de les faire évoluer positivement par sa propre exemplarité, devenant progressivement emblématique, référent de l’art. En ramenant l’art dans le domaine de la raison par la création d’un concept du jeu vers lequel doit tendre l’acteur (définition a priori d’une base technique qui a pour fonction l’embellissement), Servandoni d’Hannetaire recadre l’art dans le domaine de la connaissance afin qu’il puisse être appréciablement et justement jugeable. D’où l’importance de la figure du maître, à la fois héritier de l’art et guide. Maîtriser l’art c’est apprendre à se juger, à mesurer l’impact des effets préparés mais aussi à juger les autres ; c’est, surtout, acquérir une manière de s’y prendre avant de devenir non pas uniquement un acteur, mais véritablement Acteur, l’art transcendé, sublimé prenant alors l’apparence de la nature.
Tout prosaïsme, toute absence d’art sont donc à proscrire parce qu’ils symbolisent le bas, le commun, l’ordinaire, le non art, selon Diderot. Si la représentation a un cadre de jeu c’est-à-dire une technique de base, elle doit cependant être elle-même encadrée. La pure nature restant enserrée dans son horizontalité ne permet aucune élévation. Or la représentation doit tendre vers un idéal : la perfection. Il faut donc une mise à distance de l’objet-texte par l’acteur grâce à la création du modèle imaginaire, modèle qui seul est à même d’entraîner une identification de l’acteur à son personnage (une sorte d’identification première, pré-scénique), c’est-à-dire non pas une fusion avec lui mais une altérité en devenant sa copie, altérité qui s’accompagne d’une cessation de la séité (soi) au profit de la quiddité (ce que nous nommons le Ça, compris comme le rôle à l’état de texte, le contenu fixe, déterminé, formé par des mots, extérieur à l’acteur, mais devant être actualisé par celui-ci, sur scène, dans son ensemble et dans les détails) (11) :
" Cependant suivez-la (Mlle Clairon), étudiez-la, et vous vous convaincrez bientôt qu’elle sait par cœur tous les détails de son jeu comme toutes les paroles de son rôle. Elle a eu sans doute dans sa tête un modèle auquel elle s’est étudiée d’abord à se conformer ; sans doute elle a conçu ce modèle le plus haut, le plus grand, le plus parfait qu’elle a pu ; mais ce modèle, ce n’est pas elle " . (12)
Le modèle imaginaire conçu par Diderot est ainsi l’espace de transition ou de transit où l’acteur se dépouille de son moi, ou serait-il plus juste de dire l’oublie, pour tenter de conquérir l’idéalité de l’objet-texte, pour recueillir en son esprit la substantifique universalité de celui-ci. D’où encore cette idée d’élévation, d’élargissement et d’agrandissement, de métamorphose au théâtre, par le faire théâtral. Ainsi Mlle Clairon de nature est petite, mais se transforme, ou plutôt se transfigure, sur scène, en grande Agrippine. L’Actrice n’est pas la personne. En ce sens, Diderot donne à l’acteur la signification ancienne de personnage, d’où d’ailleurs l’utilisation presque systématique du terme « comédien » pour désigner la personne. D’où la différence établie entre un Tartuffe et le Tartuffe : il s’agit de caractériser le personnage tel que l’a imaginé l’auteur sans transférer ses caractéristiques propres sur le rôle.
Le fait théâtral entérine un changement d’identité, mais aussi une différence de nature ontologique entre l’acteur et le caractère devant être joué, qui s’amorcent dès l’étude du rôle : « Quelle étude ne faut-il pas faire d’abord pour cesser d’être soi ? pour s’identifier avec chaque personnage ? [ …] Devais-je prêter à ces rôles mes propres sentiments et ma façon d’être habituelle ? Non, sans doute. Que pouvais-je substituer à mes idées, mes sentiments, mon être enfin ? L’art, parce qu’il n’y a que cela . » (13) écrira Mlle Clairon en 1798 dans ses propres Réflexions sur l’art dramatique, confortant en cela les vues du philosophe. La relation qui s’établit entre le Ça et le Moi est ainsi, par essence, de disconvenance. Elle s’élabore dans une esthétique de la rupture, et surtout de l’écart de nature ― lequel n’est résolu que par l’adaptation de la forme (l’acteur) au contenu. Cet écart se réalise grâce au concours de l’art, grâce à un effort de superposition et d’ajustement « dilatoires », du Moi au Ça. Le corps de l’acteur devient ainsi reflet, par l’effet et l’efficacité conjugués de "l’imagisation" (visualisation objective du rôle visant à le doter des attributs physiques, comportementaux et vestimentaires qui lui sont propres) et de "l’imaginisation" (intellectualisation et rationalisation du rôle comprenant le texte et le hors-texte) du Ça. L’élévation vers le rôle passe donc parallèlement par une phase d’expansion du Moi, qui n’est dès lors jamais ramené vers le prosaïque, c’est-à-dire réduit à sa propre « petitesse », l’exiguïté qu’est l’individu(el) (la personne et la personnalité). En souhaitant une scrupuleuse fidélité au Ça, Diderot impose à l’acteur de rester toujours en retrait, d’entretenir une relation distanciée avec le personnage afin de pouvoir le scruter, l’observer à sa guise et finalement, de manière paradoxale, se l’approprier. En effet, en prenant en considération la création de l’auteur dans toute son étendue, l’acteur part à la rencontre de ce qui lui est étranger. La construction du modèle imaginaire s’effectue donc dans un mouvement d’ouverture vers le monde, permettant un enrichissement personnel, un accroissement du « capital Acteur », de même qu’un approfondissement, ou plutôt une emphase du modèle. Simulacre préparé en amont de la représentation, il est perfectible, et, de fait, est constamment soumis à cette tension devant conduire au Beau. L’acteur rature, efface, reprend, recolore le portrait jusqu’à obtention d’un modèle supérieur :
" Quand à force de travail, elle (Mlle Clairon) a approché de ce modèle idéal le plus près qu’il lui a été possible, tout est fait. Je ne doute point qu’elle n’éprouve en elle un grand tourment dans les premiers moments de ses études ; mais ces premiers moments passés, son âme est calme ; elle se possède, elle se répète sans presque aucune émotion intérieure, ses essais ont tout fixé, tout arrêté dans sa tête "(14) .
Le processus créatif apparaît, selon Diderot, purement mental. Il se déroule avant la représentation et s’effectue dans la durée : le temps de gestation de la pièce. Seule la cérébralité est utile à l’acteur. Une mise en sensible qui soit la plus proche possible du Beau, c’est-à-dire relevée, ne peut s’accomplir que par l’intermédiaire d’instruments spirituels tels l’intelligence, le tact ou l’imagination. Diderot demande donc à l’acteur de se comporter comme le sage, en gardant toujours un certain éloignement par rapport au modèle afin de l’avoir sans cesse en ligne de mire. La mise en perspective entraîne une totale maîtrise et de soi, et du modèle dans toutes ses composantes. On sauvegarde ainsi la dichotomie acteur-personnage et acteur-personne. Diderot rêve d’un acteur qui demeure imperturbable, à la fois de glace et glace (« miroir » du monde), qui adopte une position de spectateur (« disciple attentif ») pour pouvoir saisir l’image globale du personnage devant apparaître au public, et qui, au moment de la représentation, sert de réflecteur. Contrairement à l’homme soumis à ses passions qui est placé de façon permanente dans une situation de réactivité face au monde, l’acteur idéal selon le philosophe est de nature contemplative, et en ce sens, « froid ». Il est dans le voir ou le percevoir, mais non dans l’agir ou le réagir.
L’identification au modèle imaginaire se fait dans la vision – le mirage dansant devant les yeux de l’acteur, telle une illusion –, mais non dans l’action, c’est-à-dire sur scène par le jeu. Diderot demande de manière quelque peu ambiguë à l’acteur, de ne jamais se comporter en Acteur mais en Spectateur avant la représentation. D’où l’impossibilité d’introspection. L’acteur quand bien même il visualiserait dans son mental le personnage, conserve néanmoins un détachement par rapport à celui-ci. Il baigne dans une sorte d’extériorité-intérieure. La coupure entre le Ça et le Moi préserve l’acteur de la folie, la raison servant de garde-fou, cependant que la sensibilité est quant à elle préalablement mise en berne. L’émotivité est entièrement soumise à l’entendement afin de n’engendrer aucune perturbation mentale. Ainsi l’image de l’homme saisi par un événement soudain et tragique dont « les entrailles s’émeuvent subitement », dont « la tête se perd et les larmes coulent » (15) vient cimenter la démonstration, suggérant qu’une subordination de l’esprit à l’affect est désastreuse, l’homme ne pouvant plus dès lors se contrôler, ni même être conscient de lui-même – d’où, conséquemment, une perte d’identité inadmissible dans une esthétique qui s’attache au contraire à la coupure nettement marquée entre l’être et le joué. L’acteur se définit donc fondamentalement comme un observateur « insensible » : de l’Homme et du monde. Témoin oculaire, il emmagasine des savoirs, mémorise, analyse, tire des leçons de ses expériences, puis rassemblant l’ensemble de ses connaissances il peut faire preuve d’invention dans la plus stricte quiétude d’âme. Vairon, son regard se porte à la fois sur le monde et sur son modèle : « comme immobiles entre la nature humaine et l’image qu’ils en ont ébauchée, ils portent alternativement un coup d’œil attentif sur l’une et sur l’autre, et les beautés qu’ils répandent ainsi dans leurs ouvrages sont d’un succès bien autrement assuré que celles qu’ils y ont jetées dans la première boutade . » (16) L’acteur est ainsi comparable à l’auteur. Constamment tourné vers le dehors il néglige sa propre vie intérieure. Absorbé par le monde, il se soustrait à toute perturbation interne : « ils sont trop occupés à regarder et à imiter pour être vivement affectés au-dedans d’eux-mêmes. » écrit ainsi Diderot à propos de ceux qui passent leur temps à mirer autrui. L’attention de l’acteur doit, de même, se porter entièrement vers ce qui lui est hétérogène, inconnu, étranger (hors de son être, comme n’appartenant pas au Moi). L’Acteur pratique donc un Art de l’extériorité. L’étude permet de maintenir sa concentration – sa focalisation – en excentration. Elle conserve au rôle son didactisme, sa « portée ». C’est elle qui permet la conversion de l’idéalité du Ça en lisibilité scénique formelle, en caractère achevé, voire parachevé.
L’Art est donc obligatoire car filtrant et transcendant. C’est dans la conceptualisation du modèle imaginaire que l’acteur se montre véritablement artiste et créatif pour Diderot. L’esquisse du jeu n’est jamais un simple jet, né sous le coup de l’inspiration. Sorte de couture, devenant trame psychologique, le modèle imaginaire, est sans cesse repris et reprisé par l’acteur afin d’être « mis en beauté » selon des conventions où priment le vraisemblable et le bienséant. Diderot considère que le simulacre doit être abouti, finement tissé. Avant de pouvoir être exposé et exhibé au public il est finale de l’œuvre (d’Art), intégralement finalisé (l’ultime image inventée, recelant en son sein tous les effets prévus). La création est achevée avant même d’être incarnée. La représentation n’est qu’exécution, non composition.
La Beauté selon Diderot réside dans le spirituel. L’Art de l’Acteur se situe lui aussi à un niveau spirituel. Il est à la fois mis en scène, soit « accouché », et mise en scène, soit conçu mentalement. Diderot refuse toute introduction d’un jeu non médité dans la représentation car, selon lui, il n’existe pas de Beauté dans la Nature, quand bien même serait-elle visuellement (17) agréable. L’art, en tant que représentation, passe nécessairement par l’organisation et la préparation. L’harmonie fait partie des qualités inhérentes au Beau, et en tant que telle doit sous-tendre le spectacle. Le pur naturel est le plus souvent disgracieux car il se donne dans l’immédiateté et dans une certaine brutalité. Ainsi une femme éplorée, éprouvée par une forte douleur est tout entière à sa peine. Ses traits se déforment, la violence de l’affliction s’exprime de manière informelle :
Une femme malheureuse, mais vraiment malheureuse, pleure, et il arrive qu’elle ne vous touche point ; il arrive pis : c’est qu’un trait léger qui la défigure vous fait rire ; c’est qu’un accent qui lui est propre dissone à votre oreille ; c’est qu’un mouvement qui lui est habituel dans sa douleur vous la montre sous un aspect maussade ; c’est que les passions vraies ont presque toutes des grimaces que l’artiste sans goût copie servilement, mais que le grand artiste évite (18).
Diderot nie toute beauté formelle accidentelle dans la nature. Le Beau appartient, par principe, au supérieur. Le naturel ne s’accorde jamais instantanément avec le devant-être (le personnage qui doit être vu sur scène) parce qu’il n’est jamais soumis à une esthétisation. Il reste par conséquent imparfait. Or pour Diderot, l’adaptation au requis théâtral – aux conventions –, de même que la poétisation du faire théâtral sont incontournables si l’on veut que le public adhère à et entre dans l’illusion. C’est alors l’image de l’athlète mettant en scène sa propre mort qui sert de preuve à l’argumentation (19) . Toute représentation destinée à être vue s’accompagne d’un agencement poétique, d’un assujettissement aux règles de l’embellissement afin de créer une illusion semblant « naturelle ». Diderot donne alors sa propre définition du « vrai » au théâtre :
" Réfléchissez, je vous prie, sur ce qu’on appelle au théâtre être vrai. Est-ce y montrer les choses comme en nature ? Nullement : un malheureux de la rue y serait pauvre, petit, mesquin ; le vrai en ce sens ne serait autre chose que le commun. Qu’est-ce donc que le vrai ? C’est la conformité des signes extérieurs, de la voix, de la figure, du mouvement, de l’action, du discours, en un mot de toutes les parties du jeu, avec un modèle idéal ou donné par le poète ou imaginé de tête par l’acteur "(20) .
Le principe d’imitation est rappelé avec force. L’Art de l’Acteur est copie, reproduction. D’où le besoin de répétitions entre les acteurs, d’une cohérence d’ensemble afin que la représentation soit régie par la constance. L’Acteur diderotien est un Acteur apollinien qui recherche sans cesse la mesure, l’harmonie, l’équilibre : le Beau. Il est médium entre le Ça et le monde. Sa personnalité ne doit pas interférer dans le processus de mise en sensible afin de sauvegarder le plus possible la beauté du texte et du personnage. Diderot réfute toute subjectivisation du Ça par l’acteur : jouer est selon lui, différent d’être. Pour faire illusion, l’acteur doit cesser d’être lui – formule d’une redoutable logique qui ne prend toutefois pas en considération la scène en tant que telle.
Diderot a une position très classique qui n’est cependant pas foncièrement différente des autres penseurs de l’art théâtral lorsqu’il s’agit de conceptualiser la nécessité d’un modèle imaginaire avant la représentation. Cela dit, dès que le débat a trait au jeu en lui-même, au processus créatif et d’identification au moment où l’acteur entre en scène, les désaccords surgissent et se creusent, notamment en ce qui concerne les qualités dévolues à l’acteur (sensibilité ou non sensibilité) et l’esthétique même du jeu (jeu apollinien parachevé ou jeu dionysiaque fondé sur la passion naturelle et l’impulsion).
Sabine Chaouche
Sticotti, évoque, à travers ces quelques lignes, certains lieux communs relatifs à l’idée de nature au théâtre. Selon certains de ses contemporains, l’art de l’acteur n’étant qu’un art de goût, il n’est pas nécessaire d’acquérir une formation avant de se lancer à la conquête du public. Cette pensée d’un jeu où le pur naturel structurerait la représentation est spécieuse et fallacieuse selon Sticotti car si la nature est bien sujet de représentation (le référent), le faire de l’acteur quant à lui, en tant qu’art, repose sur une technique que l’acteur sait néanmoins savamment faire disparaître. La vision des spectateurs est tronquée parce qu’extérieure. L’art reste imperceptible lorsqu’il est porté à sa perfection. Il se confond alors avec la nature car telle est sa finalité, telle est la loi de l’illusion. Toutefois le naturel ne peut être confondu avec l’art : la scène théâtrale a des impératifs particuliers qu’il s’agit de respecter afin de représenter « une idée juste de la belle nature (2) ». Cette idée de Jean-François Marmontel est reprise par Denis Diderot dans ses Observations sur une brochure intitulée Garrick ou les acteurs anglais en 1770. Le philosophe pense en effet l’Acteur en termes esthétiques. Le premier jet de ce qui deviendra le Paradoxe sur le comédien se veut une apologie de l’art contre le naturel, art qui est déterminé par une conception de la représentation fondée sur le Beau.
Pour Diderot la représentation théâtrale, ne peut jamais être totalement naturelle puisque l’art de l’acteur se veut imitation (mimèsis). D’où la remarque de Diderot : « Et comment la nature, sans l’art, formerait-elle un grand comédien, puisque rien ne se passe rigoureusement sur la scène comme en nature, et que les drames sont tous composés d’après un certain système de convention et de principes ? » (3) Le philosophe fait ici référence à la poétique théâtrale. L’auteur est tenu d’écrire une pièce selon des règles (de lieu, de temps, d’unité d’action, selon la bienséance etc...). Tout art de la représentation se fonde ainsi sur des conventions. Le jeu n’y échappe pas. Désirer un acteur entièrement naturel au théâtre semble donc incohérent et absurde puisque tout est fait, dans l’art théâtral, pour que les choses ne soient pas, précisément, naturelles. Il est donc indispensable que l’acteur acquière une technique. Le jeu repose lui aussi sur une esthétisation du réel par un travail de mise en forme, c’est-à-dire de poétisation (du personnage, du vrai, de la scène), qui suppose l’agrandissement. La scène est le lieu où la nature est amplifiée, où elle doit avoir une résonance plus forte – une nature présentée sous une forme hyperbolique en quelque sorte. Tous les penseurs s’accordent sur ce point :
" si l’on entend par jouer l’effet que les touches du tableau si j’ose m’exprimer ainsi ; soient mâles, vigoureuses, les tons tranchants, la voix pleine & forte, la diction énergique, la figure expressive ; il est facile de juger que sans cela, le jeu le plus vrai, la plus belle Nature ne fera que bien peu d’effet ; & si un Acteur s’avisait de parler à voix basse, & tel qu’un Roi dans son cabinet, ce qu’il ferait serait en pure perte : mais si le débit doit être plus expressif, plus mâle au Théâtre que dans la Société ; il n’en doit pas moins être naturel, & la raison en est simple ; la conversation du Théâtre ne diffère de celle de la Société qu’en ce que dans celle-ci, ceux qui écoutent sont à portée de distinguer l’Orateur de fort près, & qu’au Théâtre ils en sont plus éloignés : or, cette distance pourra bien favoriser, en quelque sorte, l’illusion, & faire supporter sur la Scène ce qui ne serait pas supportable en Société, & qu’on verrait clairement être faux ; mais cette même distance ne fera pas trouver, dans de simples sons, cette âme qui n’y sera vraiment pas " (4) .
Tournon souligne ici par exemple que le jeu doit être soutenu au théâtre mais doit rester naturel, c’est-à-dire en rapport avec l’objet de représentation : une tonalité de voix exagérément haute, inaudible, des inflexions dans le fausset, des mouvements trop faibles ou trop véhéments qui ne reflèteraient pas dans son exactitude le personnage et la situation paraîtraient ou outrés, ou impropres au théâtre. Si le théâtral est ainsi en soi une amplification, cela ne signifie pas pour autant qu’elle soit exagération déplacée – laquelle peut néanmoins exister dans le genre comique ou farcesque, mais il est alors question de théâtralité, et non plus de ce qui est propre, naturel au théâtre. Le jeu prend donc appui, dans sa constitution même, sur des règles qui mettent en scène cet agrandissement : le port plus élevé de la voix qui impose à l’acteur une projection du souffle, l’expressivité plus marquée des traits et du geste signalent un faire spécifiquement théâtral, qui se distingue du faire ordinaire. Marmontel suggérait ainsi dès 1753 que la déclamation, qu’elle soit comique ou tragique, se plie aux mêmes règles : « par la même raison qu’un tableau destiné à être vu de loin, doit être peint à grandes touches, le ton du théâtre doit être plus haut, le langage plus soutenu, la prononciation plus marquée que dans la société, où l’on se communique de plus près, mais toujours dans les proportions de la perspective, c’est-à-dire de manière que l’expression de la voix soit réduite au degré de la nature, lorsqu’elle parvient à l’oreille des spectateurs . » (5) Le thème de l’optique revient fréquemment dans les écrits sur l’art théâtral, avec notamment la mise en parallèle du fonctionnement du théâtre antique et du théâtre français de l’époque (6) , et il semble évident dans la seconde moitié du siècle que le dire et le faire au théâtre, pour s’accomplir, répondent à des exigences qui forcent, nécessairement l’acteur, à posséder une technique. Mais le grossissement du jeu varie d’une scène à l’autre. Ainsi l’acteur s’adapte constamment à l’enceinte dans laquelle se donne la représentation. Jean Mauduit dit Larive signale par exemple à la fin du siècle que l’immensité des théâtres nuit à la beauté du spectacle tant d’un point de vue gestuel, le jeu muet passant inaperçu pour le public le plus écarté de la scène, que d’un point de vue vocal :
" Une autre cause, qui n’a pas moins contribué à énerver les effets d’une diction pure, est celle qui tient à la grandeur démesurée de nos nouvelles salles, et à leur genre de construction. La perfection du talent des comédiens tient à la vérité ; la vérité ne veut que des moyens naturels, et l’on cesse d’être vrai, lorsque l’on est forcé de composer avec ses moyens ". (7)
L’unité de la sonorité, qui était maintenue pour lors dans les petits théâtres, est désormais brisée. La taille de la salle oblige l’acteur à amplifier sa voix au maximum afin que les derniers rangs puissent l’entendre correctement. Cette trop grande vastitude a des effets pervers : certes l’augmentation du volume de la voix apparaît agréable et obligatoire pour les spectateurs assez éloignés du plateau. Cela dit, les premiers rangs, ont quant à eux les oreilles déchirées par une sonorité trop élevée et véhémente. De plus, il n’est guère loisible, à tous les acteurs d’être parfaitement maîtres de la technique de projection de la voix. Certains se contraignent, et de fait, forcent leur voix qui devient criarde, puis de plus en plus altérée. L’acteur monte de plus en plus dans les aigus, d’où une fatigue croissante, une voix qui s’éraille et s’éteint. D’autres travestissent leur voix :
" Si la grandeur de la salle ne lui permet pas d’animer et d’échauffer le public dans les choses qui n’exigent que l’accent du sentiment et la vérité simple, il s’attache alors aux intonations fortes qui lui ont le plus réussi ; il les ramène sans cesse, et, par-là, tombe dans une monotonie qui devient, à la longue, fastidieuse et insoutenable. N’étant plus le maître de s’abandonner aux émotions qu’il éprouve, toujours en garde contre la faiblesse de ses moyens, lorsqu’il est vraiment ému, il est obligé de se souvenir que trois mille personnes, qui veulent l’entendre, ne lui feraient pas grâce d’un soupir s’il est étouffé. Quand l’acteur sacrifie l’accent sentimental de sa voix, tout est perdu pour le talent . "(8)
L’acteur, dans sa volonté de plaire au public tombe dans l’affectation. Il lui est impossible de conserver des accents naturels et variés, trop (pré)occupé qu’il est à être audible. La voix forcée perd de sa souplesse : l’acteur crie continûment au lieu de « parler », s’époumone en pure perte. Les inflexions qui font les délices des spectateurs, qui condensent le sentiment en de subtiles modulations disparaissent, laissant place à un long et uniforme râle déclamatoire. La beauté au théâtre naît ainsi, en premier lieu, d’une maîtrise technique.
Le théâtre de société est aussi dans sa représentation, radicalement différent de la Comédie-Française. L’anecdote de l’actrice remarquable dans un salon puis médiocre sur une scène publique d’un grand théâtre qui étaye la démonstration de Diderot (9) , exclut tout faire théâtral qui ne serait pas en adéquation avec la taille du lieu et de l’auditoire. L’espace de créativité, le cadre de jeu apparaît ainsi déterminant. Tout au théâtre est démesuré de sorte qu’il ne peut jamais y avoir de vrai naturel chez l’acteur (c’est un « naturel » de lieu et de circonstances). La technique sert à conférer au rôle une dimension supérieure afin qu’il fasse effet sur le spectateur. La notion d’élévation, de même que les rapports entre haut et bas sont alors capitaux dans l’esthétique du Beau artistique chez Diderot. Un théâtre qui serait présentation de la nature et non représentation de celle-ci nierait l’existence d’un art de l’acteur, l’illusion n’ayant plus aucune part dans le spectacle. Tout un chacun pourrait se proclamer acteur et aucune distinction ne pourrait être établie entre un simple néophyte et un génie. L’art, pour le coup, ne serait plus livré qu’au goût. C’est pourquoi un acteur-penseur comme Jean-Nicolas Servandoni d’Hannetaire, qui a des vues similaires à tous les théoriciens de l’époque ― la notion d’art n’étant jamais infirmée en soi mais simplement nuancée (le degré d’Art que l’acteur doit cultiver et appliquer) ―, insiste sur la nécessité d’avoir des règles structurant le jeu afin de délivrer l’art du jugement esthétique du spectateur et de cette croyance en un absolu naturel de l’acteur :
" Oh ! mais… La nature ! s’écrie-t-on sans cesse, n’écoutez, ne suivez que la nature… Car c’est là le refrain ordinaire qu’on semble répéter par écho, la nature !… Mais vraiment c’est ne rien dire ; on ne doute point qu’il ne faille suivre la nature, puisqu’elle est le principe général de tous les arts. Dites plutôt comment il faut s’y prendre pour la suivre, indiquez-en les vrais moyens, et cela vaudra mieux qu’un précepte vague, qui ne signifie presque rien, surtout aux yeux d’un Commençant " . (10)
S’il ne peut y avoir de règles pour juger du Beau – le jugement esthétique reposant intrinsèquement sur un goût arbitraire –, l’art doit néanmoins s’affirmer à travers l’idée de la belle représentation, laquelle ne peut concrètement se réaliser que par l’application d’un ensemble de conventions aptes à améliorer qualitativement le faire théâtral. La formation de l’acteur concourt à embellir la nature mais aussi l’art qui, dès lors, se survit en tant qu’art à part entière et spécifique au théâtre : en se perfectionnant, l’acteur non seulement assimile tous les acquis, autrement dit tous les codes existants, tous les préceptes qui se sont constitués a posteriori parce qu’ils ont été cautionnés par le temps (par exemple l’actio oratoire héritée de l’Antiquité), mais ne cesse de les amender, de les renouveler, de les faire évoluer positivement par sa propre exemplarité, devenant progressivement emblématique, référent de l’art. En ramenant l’art dans le domaine de la raison par la création d’un concept du jeu vers lequel doit tendre l’acteur (définition a priori d’une base technique qui a pour fonction l’embellissement), Servandoni d’Hannetaire recadre l’art dans le domaine de la connaissance afin qu’il puisse être appréciablement et justement jugeable. D’où l’importance de la figure du maître, à la fois héritier de l’art et guide. Maîtriser l’art c’est apprendre à se juger, à mesurer l’impact des effets préparés mais aussi à juger les autres ; c’est, surtout, acquérir une manière de s’y prendre avant de devenir non pas uniquement un acteur, mais véritablement Acteur, l’art transcendé, sublimé prenant alors l’apparence de la nature.
Tout prosaïsme, toute absence d’art sont donc à proscrire parce qu’ils symbolisent le bas, le commun, l’ordinaire, le non art, selon Diderot. Si la représentation a un cadre de jeu c’est-à-dire une technique de base, elle doit cependant être elle-même encadrée. La pure nature restant enserrée dans son horizontalité ne permet aucune élévation. Or la représentation doit tendre vers un idéal : la perfection. Il faut donc une mise à distance de l’objet-texte par l’acteur grâce à la création du modèle imaginaire, modèle qui seul est à même d’entraîner une identification de l’acteur à son personnage (une sorte d’identification première, pré-scénique), c’est-à-dire non pas une fusion avec lui mais une altérité en devenant sa copie, altérité qui s’accompagne d’une cessation de la séité (soi) au profit de la quiddité (ce que nous nommons le Ça, compris comme le rôle à l’état de texte, le contenu fixe, déterminé, formé par des mots, extérieur à l’acteur, mais devant être actualisé par celui-ci, sur scène, dans son ensemble et dans les détails) (11) :
" Cependant suivez-la (Mlle Clairon), étudiez-la, et vous vous convaincrez bientôt qu’elle sait par cœur tous les détails de son jeu comme toutes les paroles de son rôle. Elle a eu sans doute dans sa tête un modèle auquel elle s’est étudiée d’abord à se conformer ; sans doute elle a conçu ce modèle le plus haut, le plus grand, le plus parfait qu’elle a pu ; mais ce modèle, ce n’est pas elle " . (12)
Le modèle imaginaire conçu par Diderot est ainsi l’espace de transition ou de transit où l’acteur se dépouille de son moi, ou serait-il plus juste de dire l’oublie, pour tenter de conquérir l’idéalité de l’objet-texte, pour recueillir en son esprit la substantifique universalité de celui-ci. D’où encore cette idée d’élévation, d’élargissement et d’agrandissement, de métamorphose au théâtre, par le faire théâtral. Ainsi Mlle Clairon de nature est petite, mais se transforme, ou plutôt se transfigure, sur scène, en grande Agrippine. L’Actrice n’est pas la personne. En ce sens, Diderot donne à l’acteur la signification ancienne de personnage, d’où d’ailleurs l’utilisation presque systématique du terme « comédien » pour désigner la personne. D’où la différence établie entre un Tartuffe et le Tartuffe : il s’agit de caractériser le personnage tel que l’a imaginé l’auteur sans transférer ses caractéristiques propres sur le rôle.
Le fait théâtral entérine un changement d’identité, mais aussi une différence de nature ontologique entre l’acteur et le caractère devant être joué, qui s’amorcent dès l’étude du rôle : « Quelle étude ne faut-il pas faire d’abord pour cesser d’être soi ? pour s’identifier avec chaque personnage ? [ …] Devais-je prêter à ces rôles mes propres sentiments et ma façon d’être habituelle ? Non, sans doute. Que pouvais-je substituer à mes idées, mes sentiments, mon être enfin ? L’art, parce qu’il n’y a que cela . » (13) écrira Mlle Clairon en 1798 dans ses propres Réflexions sur l’art dramatique, confortant en cela les vues du philosophe. La relation qui s’établit entre le Ça et le Moi est ainsi, par essence, de disconvenance. Elle s’élabore dans une esthétique de la rupture, et surtout de l’écart de nature ― lequel n’est résolu que par l’adaptation de la forme (l’acteur) au contenu. Cet écart se réalise grâce au concours de l’art, grâce à un effort de superposition et d’ajustement « dilatoires », du Moi au Ça. Le corps de l’acteur devient ainsi reflet, par l’effet et l’efficacité conjugués de "l’imagisation" (visualisation objective du rôle visant à le doter des attributs physiques, comportementaux et vestimentaires qui lui sont propres) et de "l’imaginisation" (intellectualisation et rationalisation du rôle comprenant le texte et le hors-texte) du Ça. L’élévation vers le rôle passe donc parallèlement par une phase d’expansion du Moi, qui n’est dès lors jamais ramené vers le prosaïque, c’est-à-dire réduit à sa propre « petitesse », l’exiguïté qu’est l’individu(el) (la personne et la personnalité). En souhaitant une scrupuleuse fidélité au Ça, Diderot impose à l’acteur de rester toujours en retrait, d’entretenir une relation distanciée avec le personnage afin de pouvoir le scruter, l’observer à sa guise et finalement, de manière paradoxale, se l’approprier. En effet, en prenant en considération la création de l’auteur dans toute son étendue, l’acteur part à la rencontre de ce qui lui est étranger. La construction du modèle imaginaire s’effectue donc dans un mouvement d’ouverture vers le monde, permettant un enrichissement personnel, un accroissement du « capital Acteur », de même qu’un approfondissement, ou plutôt une emphase du modèle. Simulacre préparé en amont de la représentation, il est perfectible, et, de fait, est constamment soumis à cette tension devant conduire au Beau. L’acteur rature, efface, reprend, recolore le portrait jusqu’à obtention d’un modèle supérieur :
" Quand à force de travail, elle (Mlle Clairon) a approché de ce modèle idéal le plus près qu’il lui a été possible, tout est fait. Je ne doute point qu’elle n’éprouve en elle un grand tourment dans les premiers moments de ses études ; mais ces premiers moments passés, son âme est calme ; elle se possède, elle se répète sans presque aucune émotion intérieure, ses essais ont tout fixé, tout arrêté dans sa tête "(14) .
Le processus créatif apparaît, selon Diderot, purement mental. Il se déroule avant la représentation et s’effectue dans la durée : le temps de gestation de la pièce. Seule la cérébralité est utile à l’acteur. Une mise en sensible qui soit la plus proche possible du Beau, c’est-à-dire relevée, ne peut s’accomplir que par l’intermédiaire d’instruments spirituels tels l’intelligence, le tact ou l’imagination. Diderot demande donc à l’acteur de se comporter comme le sage, en gardant toujours un certain éloignement par rapport au modèle afin de l’avoir sans cesse en ligne de mire. La mise en perspective entraîne une totale maîtrise et de soi, et du modèle dans toutes ses composantes. On sauvegarde ainsi la dichotomie acteur-personnage et acteur-personne. Diderot rêve d’un acteur qui demeure imperturbable, à la fois de glace et glace (« miroir » du monde), qui adopte une position de spectateur (« disciple attentif ») pour pouvoir saisir l’image globale du personnage devant apparaître au public, et qui, au moment de la représentation, sert de réflecteur. Contrairement à l’homme soumis à ses passions qui est placé de façon permanente dans une situation de réactivité face au monde, l’acteur idéal selon le philosophe est de nature contemplative, et en ce sens, « froid ». Il est dans le voir ou le percevoir, mais non dans l’agir ou le réagir.
L’identification au modèle imaginaire se fait dans la vision – le mirage dansant devant les yeux de l’acteur, telle une illusion –, mais non dans l’action, c’est-à-dire sur scène par le jeu. Diderot demande de manière quelque peu ambiguë à l’acteur, de ne jamais se comporter en Acteur mais en Spectateur avant la représentation. D’où l’impossibilité d’introspection. L’acteur quand bien même il visualiserait dans son mental le personnage, conserve néanmoins un détachement par rapport à celui-ci. Il baigne dans une sorte d’extériorité-intérieure. La coupure entre le Ça et le Moi préserve l’acteur de la folie, la raison servant de garde-fou, cependant que la sensibilité est quant à elle préalablement mise en berne. L’émotivité est entièrement soumise à l’entendement afin de n’engendrer aucune perturbation mentale. Ainsi l’image de l’homme saisi par un événement soudain et tragique dont « les entrailles s’émeuvent subitement », dont « la tête se perd et les larmes coulent » (15) vient cimenter la démonstration, suggérant qu’une subordination de l’esprit à l’affect est désastreuse, l’homme ne pouvant plus dès lors se contrôler, ni même être conscient de lui-même – d’où, conséquemment, une perte d’identité inadmissible dans une esthétique qui s’attache au contraire à la coupure nettement marquée entre l’être et le joué. L’acteur se définit donc fondamentalement comme un observateur « insensible » : de l’Homme et du monde. Témoin oculaire, il emmagasine des savoirs, mémorise, analyse, tire des leçons de ses expériences, puis rassemblant l’ensemble de ses connaissances il peut faire preuve d’invention dans la plus stricte quiétude d’âme. Vairon, son regard se porte à la fois sur le monde et sur son modèle : « comme immobiles entre la nature humaine et l’image qu’ils en ont ébauchée, ils portent alternativement un coup d’œil attentif sur l’une et sur l’autre, et les beautés qu’ils répandent ainsi dans leurs ouvrages sont d’un succès bien autrement assuré que celles qu’ils y ont jetées dans la première boutade . » (16) L’acteur est ainsi comparable à l’auteur. Constamment tourné vers le dehors il néglige sa propre vie intérieure. Absorbé par le monde, il se soustrait à toute perturbation interne : « ils sont trop occupés à regarder et à imiter pour être vivement affectés au-dedans d’eux-mêmes. » écrit ainsi Diderot à propos de ceux qui passent leur temps à mirer autrui. L’attention de l’acteur doit, de même, se porter entièrement vers ce qui lui est hétérogène, inconnu, étranger (hors de son être, comme n’appartenant pas au Moi). L’Acteur pratique donc un Art de l’extériorité. L’étude permet de maintenir sa concentration – sa focalisation – en excentration. Elle conserve au rôle son didactisme, sa « portée ». C’est elle qui permet la conversion de l’idéalité du Ça en lisibilité scénique formelle, en caractère achevé, voire parachevé.
L’Art est donc obligatoire car filtrant et transcendant. C’est dans la conceptualisation du modèle imaginaire que l’acteur se montre véritablement artiste et créatif pour Diderot. L’esquisse du jeu n’est jamais un simple jet, né sous le coup de l’inspiration. Sorte de couture, devenant trame psychologique, le modèle imaginaire, est sans cesse repris et reprisé par l’acteur afin d’être « mis en beauté » selon des conventions où priment le vraisemblable et le bienséant. Diderot considère que le simulacre doit être abouti, finement tissé. Avant de pouvoir être exposé et exhibé au public il est finale de l’œuvre (d’Art), intégralement finalisé (l’ultime image inventée, recelant en son sein tous les effets prévus). La création est achevée avant même d’être incarnée. La représentation n’est qu’exécution, non composition.
La Beauté selon Diderot réside dans le spirituel. L’Art de l’Acteur se situe lui aussi à un niveau spirituel. Il est à la fois mis en scène, soit « accouché », et mise en scène, soit conçu mentalement. Diderot refuse toute introduction d’un jeu non médité dans la représentation car, selon lui, il n’existe pas de Beauté dans la Nature, quand bien même serait-elle visuellement (17) agréable. L’art, en tant que représentation, passe nécessairement par l’organisation et la préparation. L’harmonie fait partie des qualités inhérentes au Beau, et en tant que telle doit sous-tendre le spectacle. Le pur naturel est le plus souvent disgracieux car il se donne dans l’immédiateté et dans une certaine brutalité. Ainsi une femme éplorée, éprouvée par une forte douleur est tout entière à sa peine. Ses traits se déforment, la violence de l’affliction s’exprime de manière informelle :
Une femme malheureuse, mais vraiment malheureuse, pleure, et il arrive qu’elle ne vous touche point ; il arrive pis : c’est qu’un trait léger qui la défigure vous fait rire ; c’est qu’un accent qui lui est propre dissone à votre oreille ; c’est qu’un mouvement qui lui est habituel dans sa douleur vous la montre sous un aspect maussade ; c’est que les passions vraies ont presque toutes des grimaces que l’artiste sans goût copie servilement, mais que le grand artiste évite (18).
Diderot nie toute beauté formelle accidentelle dans la nature. Le Beau appartient, par principe, au supérieur. Le naturel ne s’accorde jamais instantanément avec le devant-être (le personnage qui doit être vu sur scène) parce qu’il n’est jamais soumis à une esthétisation. Il reste par conséquent imparfait. Or pour Diderot, l’adaptation au requis théâtral – aux conventions –, de même que la poétisation du faire théâtral sont incontournables si l’on veut que le public adhère à et entre dans l’illusion. C’est alors l’image de l’athlète mettant en scène sa propre mort qui sert de preuve à l’argumentation (19) . Toute représentation destinée à être vue s’accompagne d’un agencement poétique, d’un assujettissement aux règles de l’embellissement afin de créer une illusion semblant « naturelle ». Diderot donne alors sa propre définition du « vrai » au théâtre :
" Réfléchissez, je vous prie, sur ce qu’on appelle au théâtre être vrai. Est-ce y montrer les choses comme en nature ? Nullement : un malheureux de la rue y serait pauvre, petit, mesquin ; le vrai en ce sens ne serait autre chose que le commun. Qu’est-ce donc que le vrai ? C’est la conformité des signes extérieurs, de la voix, de la figure, du mouvement, de l’action, du discours, en un mot de toutes les parties du jeu, avec un modèle idéal ou donné par le poète ou imaginé de tête par l’acteur "(20) .
Le principe d’imitation est rappelé avec force. L’Art de l’Acteur est copie, reproduction. D’où le besoin de répétitions entre les acteurs, d’une cohérence d’ensemble afin que la représentation soit régie par la constance. L’Acteur diderotien est un Acteur apollinien qui recherche sans cesse la mesure, l’harmonie, l’équilibre : le Beau. Il est médium entre le Ça et le monde. Sa personnalité ne doit pas interférer dans le processus de mise en sensible afin de sauvegarder le plus possible la beauté du texte et du personnage. Diderot réfute toute subjectivisation du Ça par l’acteur : jouer est selon lui, différent d’être. Pour faire illusion, l’acteur doit cesser d’être lui – formule d’une redoutable logique qui ne prend toutefois pas en considération la scène en tant que telle.
Diderot a une position très classique qui n’est cependant pas foncièrement différente des autres penseurs de l’art théâtral lorsqu’il s’agit de conceptualiser la nécessité d’un modèle imaginaire avant la représentation. Cela dit, dès que le débat a trait au jeu en lui-même, au processus créatif et d’identification au moment où l’acteur entre en scène, les désaccords surgissent et se creusent, notamment en ce qui concerne les qualités dévolues à l’acteur (sensibilité ou non sensibilité) et l’esthétique même du jeu (jeu apollinien parachevé ou jeu dionysiaque fondé sur la passion naturelle et l’impulsion).
Sabine Chaouche
NOTES
(1) STICOTTI, Garrick ou les acteurs anglais, Paris, Lacombe, 1769, p. 9-10.
(2) Jean-François MARMONTEL, Article « déclamation théâtrale », dans Encyclopédie, 1753, éditions Redon, CD-rom.
(3) Denis DIDEROT, Observations sur une brochure intitulée Garrick ou les acteurs anglais, 1770 dans Correspondance littéraire, philosophique et critique, Paris, Garnier, 1879, t. 9, p. 134.
(4) TOURNON, L’Art du comédien, vu dans ses principes, Paris, Cailleau et Duchesne, 1782, p. 38-40.
(5) MARMONTEL, op. cit.
(6) Cf. Claude-Joseph DORAT, La Déclamation théâtrale, Paris, S. Jorry, 1766, p. 5-7 : « Ils se guindaient sur une espèce de chaussure appelée Cothurne : non contents de ce piédestal, ils se grossissaient par le milieu du corps, afin que leur circonférence fut proportionnée à leur élévation ; de sorte que Philoctète, Agamemnon ne se montraient aux yeux des Spectateurs que bien matelassés, bien rembourrés, et avec une taille gigantesque. Tout cela paraît monstrueux, et le serait effectivement parmi nous, qui sommes emprisonnés dans nos salles de Spectacles, et presque confondus avec les Acteurs ; mais, comment, dans la poussière de ces granges mal décorées, pouvons-nous rapprocher l’Optique des immenses Théâtres de la Grèce et de Rome ? Sans les précautions que l’on prenait alors, tous les grands personnages qui figuraient dans les Drames, n’auraient eu l’air que de Pygmées ; la vraisemblance était manquée, l’illusion détruite. Cette exagération prétendue, savamment combinée avec les effets de la perspective, rentrait dans l’ordre de la Nature, et ne pouvait déplaire qu’à un esprit cynique et mordant qui, n’épargnant pas les Dieux mêmes, ne se faisait aucun scrupule de s’égayer sur des Comédiens. »
(7) Jean MAUDUIT dit LARIVE, Réflexions sur l’art théâtral, Paris, Rondonneau, 1801, p. 4-5.
(8) MAUDUIT dit LARIVE, op. cit., p. 5. L’acteur ajoute : « L’ancienne salle du faubourg Saint-Germain est celle où Thalie et Melpomène avaient établi leur empire et où l’on a vu leur plus beau règne ; c’est là que se sont formés les Dumesnil, les Clairon, les Gaussin, les Dangeville, les Baron, les Le Kain, les Brisard, les Préville, etc. etc. Cette salle avait les justes proportions favorables à tous les accents de la voix ; et ces accents ne perdaient rien de leur charme dans les intonations, même les plus moelleuses et les plus simples ; les spectateurs y jouissaient sans effort et sans inquiétude : le théâtre, plus facile à éclairer, permettait de tout voir, et la scène muette n’était pas perdue comme elle l’est aujourd’hui. Le célèbre Le Kain était si persuadé qu’une trop grande salle est nuisible au talent et à la vérité, qu’il ne voulût consentir à jouer dans celle des Tuileries, qu’à condition que l’on en rapprocherait le fond : ce qui fut fait sans égard à la perte de quarante ou cinquante mille livres de recette annuelle ; et cependant cette salle était moins grande que celles qui existent aujourd’hui. Je n’ignore pas qu’il y a, en Italie, plusieurs salles immenses dans lesquelles un soupir même est entendu ; mais l’art de les construire avec cette perfection, n’est pas encore arrivé jusqu’à nous. L’essai que j’ai fait sur plus de cinquante théâtres où j’ai joué dans mes différents voyages, m’a prouvé que ceux qui sont dans de justes proportions, sont les seuls favorables. Je pouvais m’y livrer sans efforts et sans fatigue à mes moyens naturels ; je pouvais captiver les spectateurs au point de disposer à mon gré de toutes leurs sensations : pour réussir à cet égard, il faut qu’un geste, un regard puisse être saisi sans être forcé, et que le jeu de la physionomie, avant-coureur des expressions de l’âme, soit vu également de tous les spectateurs. La scène muette soutient l’intérêt de la représentation, et contribue le plus à son ensemble. Le défaut de proportion dans nos nouvelles salles, est d’autant plus nuisible au succès des acteurs, qu’il leur est impossible de satisfaire également, et ceux qui sont trop près et ceux qui sont trop loin ; ils doivent nécessairement paraître trop forcés pour les uns et trop faibles pour les autres. Marmontel dans ses observations sur l’art de la déclamation, a dit : « Qu’il fallait que la prononciation fût plus marquée que dans la société où l’on se communique de plus près, mais toujours dans les proportions de la perspective, c’est-à-dire, de manière que l’expression de la voix fût réduite au degré de nature lorsqu’elle parvient aux oreilles des spectateurs. » Je crois que Marmontel s’est trompé sur cet article ; il est impossible que la voix, si elle est forcée en sortant de la bouche de l’acteur, parvienne d’une manière naturelle aux oreilles des spectateurs ; dans ce cas elle doit nécessairement perdre son accent et son velouté, et ne peut arriver jusqu’à ceux qui sont les plus éloignés, que dure et sèche. Si l’acteur, sans égard pour la grandeur de la salle, est vrai et naturel, sa voix ne parvient alors à ceux qui sont les plus éloignés, que faible et sans expression. » (p. 5-8).
(9) DIDEROT, op. cit., p. 154-155. « Voici une expérience que vous aurez faite quelquefois : appelé par un acteur ou par une actrice, chez elle, en petit comité, pour juger de son talent, vous lui aurez trouvé de l’âme, de la sensibilité ; vous l’aurez accablée d’éloges ; vous vous en serez séparé et vous l’aurez laissée avec la conviction du plus éclatant succès. Le lendemain elle paraît, elle est sifflée ; et vous prononcez en vous-même, malgré vous, que les sifflets ont raison. D’où cela vient-il ? Est-ce qu’elle a perdu son talent d’un jour à l’autre ? Aucunement ; mais chez elle vous étiez terre à terre avec elle, vous l’écoutiez, abstraction faite des conventions ; elle était vis-à-vis de vous ; il n’y avait aucun autre terme de comparaison. Vous étiez content de son âme, de ses entrailles, de sa voix, de ses gestes, de son maintien ; tout était en proportion avec le petit auditoire, le petit espace ; rien n’exigeait de l’exagération ; sur la scène tout a disparu ; là il fallait un autre modèle qu’elle-même, puisque tout ce qui l’environnait a changé : sur un petit théâtre particulier, dans un appartement, vous spectateur de niveau avec l’acteur, le vrai modèle dramatique vous aurait paru outré, et en vous en retournant vous n’auriez pas manqué d’en faire la confidence à votre ami, et le lendemain le succès au théâtre vous aurait étonné. »
(10) Jean-Nicolas SERVANDONI D’HANNETAIRE, Observations sur l’art du comédien, Paris, aux dépens d’une société typographique, (1764) 1774, p. 29.
(11) Nous n’utilisation pas le mot « ça » en référence au concept psychiatrique établi par Georg Groddeck, mais pour désigner l’existence du texte à la fois comme objet, contenant et contenu, c’est-à-dire comme l’ensemble de toutes ses caractéristiques, comme la chose dont toutes les qualités ne sont pas forcément toutes précisables ou précisées (ainsi du contenu du sous-texte).
(12) SERVANDONI D’HANNETAIRE, op. cit., p. 137.
(13) Hyppolite CLAIRON, Mémoires et Réflexions sur l’art dramatique, Paris, Buisson, an 7, p. 30.
(14) DIDEROT, op. cit., p. 137.
(15) Ibid., p. 140.
(16) Id., p. 137-138.
(17) Cf. id., p. 148 : « Mais, me direz-vous, une foule d’hommes qui décèlent subitement, à leur manière, la sensibilité qu’ils éprouvent, font un spectacle merveilleux sans s’être concertés. D’accord ; mais ils le seraient bien davantage, je crois, s’il y avait eu entre eux un concert bien entendu ; d’ailleurs vous me parlez d’un instant fugitif, et moi je vous parle d’un ouvrage de l’art qui a sa conduite et sa durée. Prenez chacun de ces personnages, montrez-les moi successivement isolés, deux à deux, trois à trois ; abandonnez-les à leur propres mouvements, et vous verrez la cacophonie qui en résulte. »
(18) Id., p. 148.
(19) Id., p. 140-141 : « nous voulons que cette femme tombe avec décence et mollesse, et que ce héros meure comme le gladiateur ancien mourait dans l’arène aux applaudissements d’un amphithéâtre, avec grâce, avec noblesse, dans une attitude élégante et pittoresque. Qui est-ce qui remplira votre attente ? Est-ce l’athlète que sa sensibilité décompose et que la douleur subjugue, ou l’athlète académisé qui pratique les leçons sévères de la gymnastique jusqu’au dernier soupir ? Le gladiateur ancien comme un grand comédien, un grand comédien ainsi que le gladiateur ancien, ne meurt pas comme on meurt sur un lit ; ils sont forcés de jouer une autre mort pour nous plaire ; et le spectateur sentirait que la vérité d’action dénuée de tout apprêt est petite et ne s’accorde pas avec la poésie. Du reste, ce n’est pas que la pure nature n’ait ses moments sublimes ; mais je conçois que si quelqu’un est sûr de leur conserver leur sublimité, c’est celui qui les aura pressentis et qui les rendra de sens froid. »
(20) Id., p. 140. Cf . SERVANDONI D’HANNETAIRE, p. 233 de son traité.
(2) Jean-François MARMONTEL, Article « déclamation théâtrale », dans Encyclopédie, 1753, éditions Redon, CD-rom.
(3) Denis DIDEROT, Observations sur une brochure intitulée Garrick ou les acteurs anglais, 1770 dans Correspondance littéraire, philosophique et critique, Paris, Garnier, 1879, t. 9, p. 134.
(4) TOURNON, L’Art du comédien, vu dans ses principes, Paris, Cailleau et Duchesne, 1782, p. 38-40.
(5) MARMONTEL, op. cit.
(6) Cf. Claude-Joseph DORAT, La Déclamation théâtrale, Paris, S. Jorry, 1766, p. 5-7 : « Ils se guindaient sur une espèce de chaussure appelée Cothurne : non contents de ce piédestal, ils se grossissaient par le milieu du corps, afin que leur circonférence fut proportionnée à leur élévation ; de sorte que Philoctète, Agamemnon ne se montraient aux yeux des Spectateurs que bien matelassés, bien rembourrés, et avec une taille gigantesque. Tout cela paraît monstrueux, et le serait effectivement parmi nous, qui sommes emprisonnés dans nos salles de Spectacles, et presque confondus avec les Acteurs ; mais, comment, dans la poussière de ces granges mal décorées, pouvons-nous rapprocher l’Optique des immenses Théâtres de la Grèce et de Rome ? Sans les précautions que l’on prenait alors, tous les grands personnages qui figuraient dans les Drames, n’auraient eu l’air que de Pygmées ; la vraisemblance était manquée, l’illusion détruite. Cette exagération prétendue, savamment combinée avec les effets de la perspective, rentrait dans l’ordre de la Nature, et ne pouvait déplaire qu’à un esprit cynique et mordant qui, n’épargnant pas les Dieux mêmes, ne se faisait aucun scrupule de s’égayer sur des Comédiens. »
(7) Jean MAUDUIT dit LARIVE, Réflexions sur l’art théâtral, Paris, Rondonneau, 1801, p. 4-5.
(8) MAUDUIT dit LARIVE, op. cit., p. 5. L’acteur ajoute : « L’ancienne salle du faubourg Saint-Germain est celle où Thalie et Melpomène avaient établi leur empire et où l’on a vu leur plus beau règne ; c’est là que se sont formés les Dumesnil, les Clairon, les Gaussin, les Dangeville, les Baron, les Le Kain, les Brisard, les Préville, etc. etc. Cette salle avait les justes proportions favorables à tous les accents de la voix ; et ces accents ne perdaient rien de leur charme dans les intonations, même les plus moelleuses et les plus simples ; les spectateurs y jouissaient sans effort et sans inquiétude : le théâtre, plus facile à éclairer, permettait de tout voir, et la scène muette n’était pas perdue comme elle l’est aujourd’hui. Le célèbre Le Kain était si persuadé qu’une trop grande salle est nuisible au talent et à la vérité, qu’il ne voulût consentir à jouer dans celle des Tuileries, qu’à condition que l’on en rapprocherait le fond : ce qui fut fait sans égard à la perte de quarante ou cinquante mille livres de recette annuelle ; et cependant cette salle était moins grande que celles qui existent aujourd’hui. Je n’ignore pas qu’il y a, en Italie, plusieurs salles immenses dans lesquelles un soupir même est entendu ; mais l’art de les construire avec cette perfection, n’est pas encore arrivé jusqu’à nous. L’essai que j’ai fait sur plus de cinquante théâtres où j’ai joué dans mes différents voyages, m’a prouvé que ceux qui sont dans de justes proportions, sont les seuls favorables. Je pouvais m’y livrer sans efforts et sans fatigue à mes moyens naturels ; je pouvais captiver les spectateurs au point de disposer à mon gré de toutes leurs sensations : pour réussir à cet égard, il faut qu’un geste, un regard puisse être saisi sans être forcé, et que le jeu de la physionomie, avant-coureur des expressions de l’âme, soit vu également de tous les spectateurs. La scène muette soutient l’intérêt de la représentation, et contribue le plus à son ensemble. Le défaut de proportion dans nos nouvelles salles, est d’autant plus nuisible au succès des acteurs, qu’il leur est impossible de satisfaire également, et ceux qui sont trop près et ceux qui sont trop loin ; ils doivent nécessairement paraître trop forcés pour les uns et trop faibles pour les autres. Marmontel dans ses observations sur l’art de la déclamation, a dit : « Qu’il fallait que la prononciation fût plus marquée que dans la société où l’on se communique de plus près, mais toujours dans les proportions de la perspective, c’est-à-dire, de manière que l’expression de la voix fût réduite au degré de nature lorsqu’elle parvient aux oreilles des spectateurs. » Je crois que Marmontel s’est trompé sur cet article ; il est impossible que la voix, si elle est forcée en sortant de la bouche de l’acteur, parvienne d’une manière naturelle aux oreilles des spectateurs ; dans ce cas elle doit nécessairement perdre son accent et son velouté, et ne peut arriver jusqu’à ceux qui sont les plus éloignés, que dure et sèche. Si l’acteur, sans égard pour la grandeur de la salle, est vrai et naturel, sa voix ne parvient alors à ceux qui sont les plus éloignés, que faible et sans expression. » (p. 5-8).
(9) DIDEROT, op. cit., p. 154-155. « Voici une expérience que vous aurez faite quelquefois : appelé par un acteur ou par une actrice, chez elle, en petit comité, pour juger de son talent, vous lui aurez trouvé de l’âme, de la sensibilité ; vous l’aurez accablée d’éloges ; vous vous en serez séparé et vous l’aurez laissée avec la conviction du plus éclatant succès. Le lendemain elle paraît, elle est sifflée ; et vous prononcez en vous-même, malgré vous, que les sifflets ont raison. D’où cela vient-il ? Est-ce qu’elle a perdu son talent d’un jour à l’autre ? Aucunement ; mais chez elle vous étiez terre à terre avec elle, vous l’écoutiez, abstraction faite des conventions ; elle était vis-à-vis de vous ; il n’y avait aucun autre terme de comparaison. Vous étiez content de son âme, de ses entrailles, de sa voix, de ses gestes, de son maintien ; tout était en proportion avec le petit auditoire, le petit espace ; rien n’exigeait de l’exagération ; sur la scène tout a disparu ; là il fallait un autre modèle qu’elle-même, puisque tout ce qui l’environnait a changé : sur un petit théâtre particulier, dans un appartement, vous spectateur de niveau avec l’acteur, le vrai modèle dramatique vous aurait paru outré, et en vous en retournant vous n’auriez pas manqué d’en faire la confidence à votre ami, et le lendemain le succès au théâtre vous aurait étonné. »
(10) Jean-Nicolas SERVANDONI D’HANNETAIRE, Observations sur l’art du comédien, Paris, aux dépens d’une société typographique, (1764) 1774, p. 29.
(11) Nous n’utilisation pas le mot « ça » en référence au concept psychiatrique établi par Georg Groddeck, mais pour désigner l’existence du texte à la fois comme objet, contenant et contenu, c’est-à-dire comme l’ensemble de toutes ses caractéristiques, comme la chose dont toutes les qualités ne sont pas forcément toutes précisables ou précisées (ainsi du contenu du sous-texte).
(12) SERVANDONI D’HANNETAIRE, op. cit., p. 137.
(13) Hyppolite CLAIRON, Mémoires et Réflexions sur l’art dramatique, Paris, Buisson, an 7, p. 30.
(14) DIDEROT, op. cit., p. 137.
(15) Ibid., p. 140.
(16) Id., p. 137-138.
(17) Cf. id., p. 148 : « Mais, me direz-vous, une foule d’hommes qui décèlent subitement, à leur manière, la sensibilité qu’ils éprouvent, font un spectacle merveilleux sans s’être concertés. D’accord ; mais ils le seraient bien davantage, je crois, s’il y avait eu entre eux un concert bien entendu ; d’ailleurs vous me parlez d’un instant fugitif, et moi je vous parle d’un ouvrage de l’art qui a sa conduite et sa durée. Prenez chacun de ces personnages, montrez-les moi successivement isolés, deux à deux, trois à trois ; abandonnez-les à leur propres mouvements, et vous verrez la cacophonie qui en résulte. »
(18) Id., p. 148.
(19) Id., p. 140-141 : « nous voulons que cette femme tombe avec décence et mollesse, et que ce héros meure comme le gladiateur ancien mourait dans l’arène aux applaudissements d’un amphithéâtre, avec grâce, avec noblesse, dans une attitude élégante et pittoresque. Qui est-ce qui remplira votre attente ? Est-ce l’athlète que sa sensibilité décompose et que la douleur subjugue, ou l’athlète académisé qui pratique les leçons sévères de la gymnastique jusqu’au dernier soupir ? Le gladiateur ancien comme un grand comédien, un grand comédien ainsi que le gladiateur ancien, ne meurt pas comme on meurt sur un lit ; ils sont forcés de jouer une autre mort pour nous plaire ; et le spectateur sentirait que la vérité d’action dénuée de tout apprêt est petite et ne s’accorde pas avec la poésie. Du reste, ce n’est pas que la pure nature n’ait ses moments sublimes ; mais je conçois que si quelqu’un est sûr de leur conserver leur sublimité, c’est celui qui les aura pressentis et qui les rendra de sens froid. »
(20) Id., p. 140. Cf . SERVANDONI D’HANNETAIRE, p. 233 de son traité.