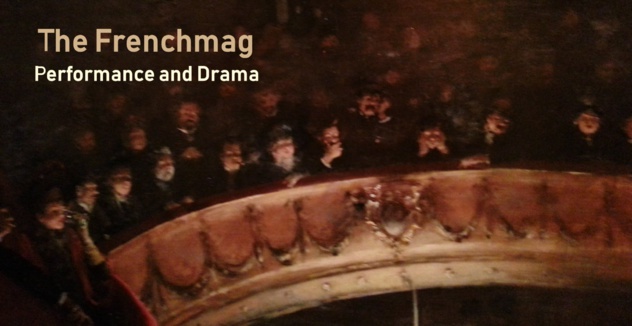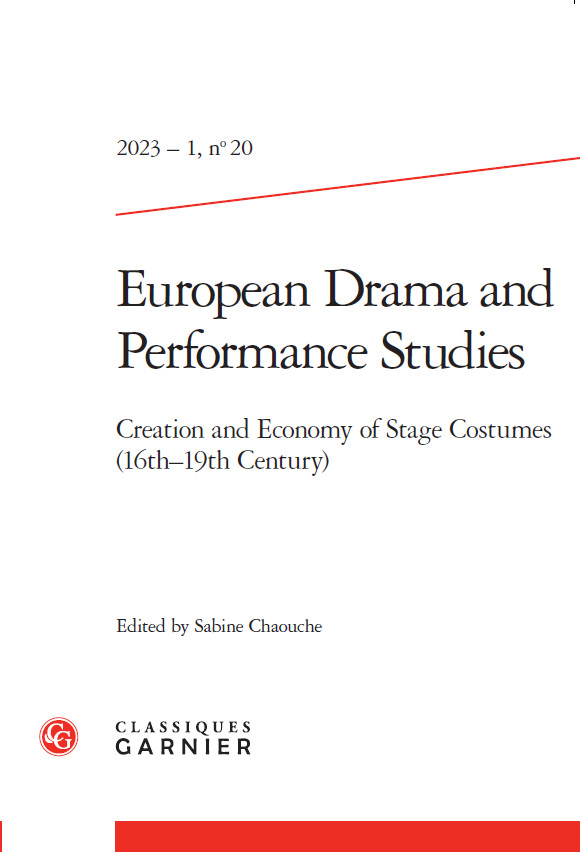Cette thèse a pour objectif de démontrer la richesse et la variété des dispositifs scéniques utilisés par Molière à Paris, à partir de 1658. Sur ce thème, il n’y eut guère jusqu’ici que des travaux peu convaincants basés sur l’étude iconographique des frontispices. Cette étude s’ouvre sur un rappel circonstancié du contexte technique, matériel et scénographique au XVIIe siècle avec notamment les descriptions précises des grandes innovations dues aux Italiens ; puis, à l’aide de notes, de manuscrits ou de contrats, les spécificités architecturales du théâtre du Palais-Royal, qui fut pour Molière le principal espace de création, sont détaillés. Enfin, l’ensemble des comédies du dramaturge est regroupé en deux grandes catégories : les comédies données à la Ville, comme L’École des femmes, Le Tartuffe ou L’Avare ; celles-ci n’ont pas bénéficié de commentaires qui puissent éclairer sur le dispositif scénique. Mais le décryptage minutieux du texte a pallié cette lacune ; il met en évidence un rapport quasi constant entre action et décoration, et confirme l’intérêt manifeste de l’auteur-comédien pour la mise en scène. La seconde catégorie concerne les comédies données pour la Cour, souvent appelées « comédies-ballets » ou comédies « mêlées musique et de danses » ; celles-ci ont fait l’objet d’amples relations contemporaines. Bénéficiant de moyens financiers considérables, elles furent caractéristiques par leur débordement de luxe et d’invention.
http://www.theses.fr/s28127
Source: ACRAS
http://www.theses.fr/s28127
Source: ACRAS