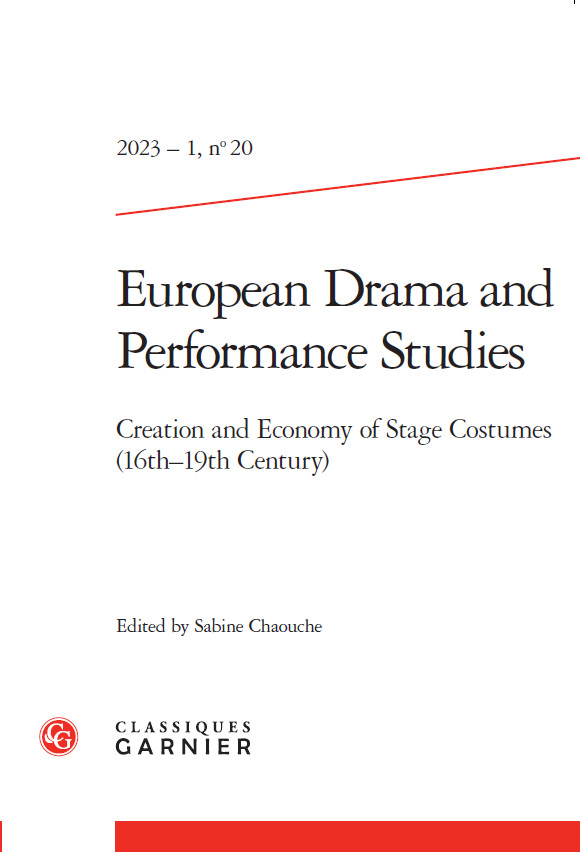Loin des fureurs massacrantes des Atrides et de l’opéra de Cavalli, l’Egisto proposé par le théâtre de l’Athénée-Louis Jouvet, présentait il y a quelques jours une variation sur une nouvelle tirée du Décaméron de Boccace à l’occasion de la découverte d’une copie parisienne de son manuscrit à la Bibliothèque nationale de France par Barbara Nestola. Cette pièce n’avait d’ailleurs plus été représentée dans la capitale depuis 1646 (c’était au temps où Mazarin tentait d’acclimater l’opéra italien en France, après le succès de La Finta Pazza l’année précédente).
Cette comédie prend aujourd’hui la revanche des critiques qu’elle avait connues au XVIIe siècle : grâce aux sous-titres, la bigarrure des dialectes n’est plus un obstacle à la compréhension, de même que la longueur de l’œuvre au plaisir, puisqu’elle est réduite aux trois-quarts de son étendue initiale (on regrettera cependant que, pour soulager les auditeurs, l’intermède de la fin du deuxième acte ait été repoussé au début du troisième, ce qui brise la continuité avec la scène précédente). Débarrassé en outre de ses implications politiques contemporaines et, qui plus est, difficilement lisible de nos jours en tant que fable de la Contre-Réforme (c’est en effet aussi une méditation allégorique sur la vertu et le renoncement), l’opéra ravit par sa fantaisie désuète et son comique typiquement baroque : un contrepoint entre domestiques (toujours affamés) et maîtres (toujours amoureux), avec scène d’écho, fausse mort et reconnaissance obligées ainsi que des intermèdes particulièrement bien intégrés au livret (de Giulio Respigliosi). Le tout allant, après différents sacrifices qui rythment le troisième acte comme autant d’épreuves de conte de fée, vers une fin heureuse, soulignée par un troisième intermède bucolique dansé, agrémenté de remarquables gazouillis d’oiseau. L’auditeur devait cependant rester vigilant, de peur de confondre les rôles puisque, outre le travesti (Christin Rocci, en « Lucinda déguisée en Armindo, domestique d’Alcida, amoureuse d’Egisto, mais sa sœur en vérité »), trois rôles masculins étaient chantés par une femme avant d’incarner d’autres personnages.
La performance est en effet entièrement servie par des artistes multi-rôles ; onze chanteurs qui participent occasionnellement à l’action, quatre danseurs qui jouent également les machinistes mais sont aussi trapézistes, les onze musiciens du groupe Les Paladins, menés par Jérôme Correas à la baguette et au clavecin (comme la harpiste tient également les percussions).
De fait, le faste d’antan n’est plus et si la musique de Marco Marassoli et Virgilio Mazzocchi continue de séduire, aussi adaptée aux lamenti qu’aux scènes comiques, le spectacle pèche néanmoins un peu par la frugalité du décor, même si l’ingéniosité des madriers transformables – planches dressées en forêt ou abaissées en tréteaux – soutient l’intérêt. La mise en scène dynamique de Jean-Denis Monory, le talent des interprètes, les costumes soignés et le jeu masqué (pour les passages de comédie) n’en apparaissent que plus saillants. Le caractère merveilleux du livret est ainsi préservé, et le spectateur peut donc retourner avec plaisir aux sources de l’enchantement opératique, tissé de charmes et de chants.
Compte rendu par Noémie Courtès.
Paris, Théâtre de l’Athénée-Louis Jouvet, 19-23 octobre 2011.
Cette comédie prend aujourd’hui la revanche des critiques qu’elle avait connues au XVIIe siècle : grâce aux sous-titres, la bigarrure des dialectes n’est plus un obstacle à la compréhension, de même que la longueur de l’œuvre au plaisir, puisqu’elle est réduite aux trois-quarts de son étendue initiale (on regrettera cependant que, pour soulager les auditeurs, l’intermède de la fin du deuxième acte ait été repoussé au début du troisième, ce qui brise la continuité avec la scène précédente). Débarrassé en outre de ses implications politiques contemporaines et, qui plus est, difficilement lisible de nos jours en tant que fable de la Contre-Réforme (c’est en effet aussi une méditation allégorique sur la vertu et le renoncement), l’opéra ravit par sa fantaisie désuète et son comique typiquement baroque : un contrepoint entre domestiques (toujours affamés) et maîtres (toujours amoureux), avec scène d’écho, fausse mort et reconnaissance obligées ainsi que des intermèdes particulièrement bien intégrés au livret (de Giulio Respigliosi). Le tout allant, après différents sacrifices qui rythment le troisième acte comme autant d’épreuves de conte de fée, vers une fin heureuse, soulignée par un troisième intermède bucolique dansé, agrémenté de remarquables gazouillis d’oiseau. L’auditeur devait cependant rester vigilant, de peur de confondre les rôles puisque, outre le travesti (Christin Rocci, en « Lucinda déguisée en Armindo, domestique d’Alcida, amoureuse d’Egisto, mais sa sœur en vérité »), trois rôles masculins étaient chantés par une femme avant d’incarner d’autres personnages.
La performance est en effet entièrement servie par des artistes multi-rôles ; onze chanteurs qui participent occasionnellement à l’action, quatre danseurs qui jouent également les machinistes mais sont aussi trapézistes, les onze musiciens du groupe Les Paladins, menés par Jérôme Correas à la baguette et au clavecin (comme la harpiste tient également les percussions).
De fait, le faste d’antan n’est plus et si la musique de Marco Marassoli et Virgilio Mazzocchi continue de séduire, aussi adaptée aux lamenti qu’aux scènes comiques, le spectacle pèche néanmoins un peu par la frugalité du décor, même si l’ingéniosité des madriers transformables – planches dressées en forêt ou abaissées en tréteaux – soutient l’intérêt. La mise en scène dynamique de Jean-Denis Monory, le talent des interprètes, les costumes soignés et le jeu masqué (pour les passages de comédie) n’en apparaissent que plus saillants. Le caractère merveilleux du livret est ainsi préservé, et le spectateur peut donc retourner avec plaisir aux sources de l’enchantement opératique, tissé de charmes et de chants.
Compte rendu par Noémie Courtès.
Paris, Théâtre de l’Athénée-Louis Jouvet, 19-23 octobre 2011.