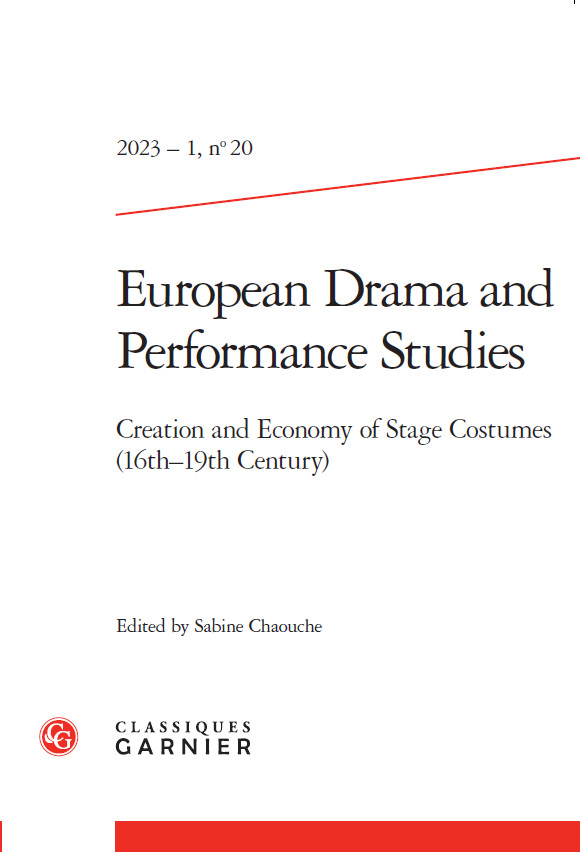Suréna est la dernière pièce écrite par Pierre Corneille, traditionnellement jugée l’enfant de sa vieillesse et de sa gloire flétrie. Elle est pourtant loin d’être une pièce mineure : elle est au contraire flamboyante de désirs impossibles et de jeunesse gâchée. Le quatuor infernal qui fait le tragique des pièces de Corneille y est plus que jamais affûté : on s’aime avec autant de haine que de flamme et la jalousie finit par prendre le pas sur l’amour. Même la gloire, pourtant si consubstantielle à l’esthétique cornélienne, en est obscurcie et dès le tout début, l’amour de Suréna pour Eurydice apparaît condamné. En dépit qu’on en ait, jamais Corneille n’a été aussi racinien et Suréna ressemble à Mithridate alors même que sa pièce tombe à l’époque devant Iphigénie.
Jouée en alternance avec une version renouvelée de Nicomède (créée une première fois en 2009 au Théâtre de la Tempête), par les mêmes acteurs et dans le même décor minimaliste, la mise en scène de Brigitte Jaques-Wajeman fait salle comble. Probablement parce que la troupe a su rendre Corneille familier. Car si la diction n’est pas parfaite, en dépit d’un souci affiché jusque dans le programme, elle rend merveilleusement la fluidité des sentiments. Les comédiens savent détacher les mots juste ce qu’il faut pour que le public comprenne sans hésitation les soubresauts de ces âmes torturées par leurs passions et qui oscillent infiniment entre la pureté du sentiment et le machiavélisme politique. Les cinq actes sont ainsi joués avec beaucoup d’allant (seulement deux heures de représentation, sans rien de l’outrance que l’on reproche d’ordinaire à la tragédie) et l’ironie tragique est d’autant plus perceptible que le dénouement arrive aussi inéluctablement que rapidement.
La relecture est patente : tragédies de la révolte contre Rome, unies par leur vision sombre du pouvoir, Nicomède apparaît ici comme une « farce noire » et Suréna tourne au mélodrame. Parti pris moderniste, l’action est en effet continuée après le dernier alexandrin, les deux héroïnes et la confidente succombant réellement, l’une à son amour, et les deux autres aux coups des séides du roi alors que le texte de Corneille résonne encore d’un ardent appel à la vengeance.
La grande simplicité du texte trouve un écho perlé dans la musique de Marc-Olivier Dupin, présente mais discrète, variée, vibrante de ses notes au xylophone et à la clarinette ainsi que dans la sobriété du décor et des accessoires, réduits quasiment à une longue table plantée en oblique recouverte de nappes qui passent du blanc au noir pour souligner l’attente de la fête puis son inaccomplissement. La situation se fait ainsi à la fois contemporaine et intemporelle puisque les robes de soie se mêlent à des uniformes informes et improbables, qu’on boit alcools forts et café, qu’on s’assoit sur des chaises empoignées sans façon pour mieux camper virilité ou royauté mises à mal.
Sans vouloir jouer les flèches du Parthe, on remarquera cependant que Suréna apparaît à cet égard parfois bien suranné, non par sa date d’écriture (1674) étant donné que la jalousie dépeinte n’a pas pris une ride, mais par sa mise en scène, lorsque l’affrontement verbal poétisé par Corneille tourne au corps à corps démodé, donnant à la mort annoncée un parfum orgasmique inutile, lorsque aimer, souffrir et mourir, la trinité matricielle de la pièce, voit sa tension érotique réduite par l’étreinte et la roulade, alors que sa beauté tragique réside bien davantage dans l’impossibilité de s’aimer, et plus encore de se toucher.
En dépit de cela (à cause de cela ? il est vrai que cette vision correspond davantage à nos habitudes d’aujourd’hui), la pièce fonctionne et la magie opère. Comment ne pas plaindre Eurydice, particulièrement touchante à la fin, drapée en blanche Tanagra ? Et en ces temps où l’on n’entend plus que du Shakespeare, il faut souligner la performance de rendre au public le goût de Corneille, et de lui donner un instant, pour Suréna, les yeux de Chimène.
Compte rendu par Noémie Courtès.
Théâtre des Abbesses, jusqu’au 13 février 2011.
Musique disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.
Jouée en alternance avec une version renouvelée de Nicomède (créée une première fois en 2009 au Théâtre de la Tempête), par les mêmes acteurs et dans le même décor minimaliste, la mise en scène de Brigitte Jaques-Wajeman fait salle comble. Probablement parce que la troupe a su rendre Corneille familier. Car si la diction n’est pas parfaite, en dépit d’un souci affiché jusque dans le programme, elle rend merveilleusement la fluidité des sentiments. Les comédiens savent détacher les mots juste ce qu’il faut pour que le public comprenne sans hésitation les soubresauts de ces âmes torturées par leurs passions et qui oscillent infiniment entre la pureté du sentiment et le machiavélisme politique. Les cinq actes sont ainsi joués avec beaucoup d’allant (seulement deux heures de représentation, sans rien de l’outrance que l’on reproche d’ordinaire à la tragédie) et l’ironie tragique est d’autant plus perceptible que le dénouement arrive aussi inéluctablement que rapidement.
La relecture est patente : tragédies de la révolte contre Rome, unies par leur vision sombre du pouvoir, Nicomède apparaît ici comme une « farce noire » et Suréna tourne au mélodrame. Parti pris moderniste, l’action est en effet continuée après le dernier alexandrin, les deux héroïnes et la confidente succombant réellement, l’une à son amour, et les deux autres aux coups des séides du roi alors que le texte de Corneille résonne encore d’un ardent appel à la vengeance.
La grande simplicité du texte trouve un écho perlé dans la musique de Marc-Olivier Dupin, présente mais discrète, variée, vibrante de ses notes au xylophone et à la clarinette ainsi que dans la sobriété du décor et des accessoires, réduits quasiment à une longue table plantée en oblique recouverte de nappes qui passent du blanc au noir pour souligner l’attente de la fête puis son inaccomplissement. La situation se fait ainsi à la fois contemporaine et intemporelle puisque les robes de soie se mêlent à des uniformes informes et improbables, qu’on boit alcools forts et café, qu’on s’assoit sur des chaises empoignées sans façon pour mieux camper virilité ou royauté mises à mal.
Sans vouloir jouer les flèches du Parthe, on remarquera cependant que Suréna apparaît à cet égard parfois bien suranné, non par sa date d’écriture (1674) étant donné que la jalousie dépeinte n’a pas pris une ride, mais par sa mise en scène, lorsque l’affrontement verbal poétisé par Corneille tourne au corps à corps démodé, donnant à la mort annoncée un parfum orgasmique inutile, lorsque aimer, souffrir et mourir, la trinité matricielle de la pièce, voit sa tension érotique réduite par l’étreinte et la roulade, alors que sa beauté tragique réside bien davantage dans l’impossibilité de s’aimer, et plus encore de se toucher.
En dépit de cela (à cause de cela ? il est vrai que cette vision correspond davantage à nos habitudes d’aujourd’hui), la pièce fonctionne et la magie opère. Comment ne pas plaindre Eurydice, particulièrement touchante à la fin, drapée en blanche Tanagra ? Et en ces temps où l’on n’entend plus que du Shakespeare, il faut souligner la performance de rendre au public le goût de Corneille, et de lui donner un instant, pour Suréna, les yeux de Chimène.
Compte rendu par Noémie Courtès.
Théâtre des Abbesses, jusqu’au 13 février 2011.
Musique disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.