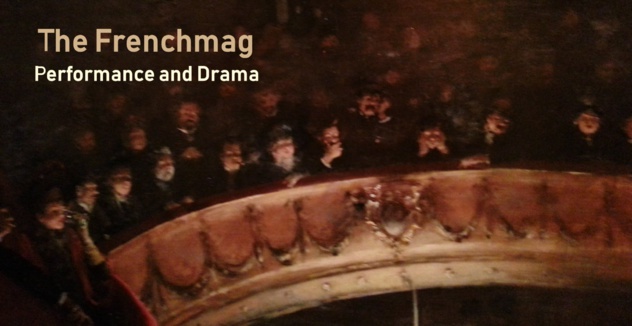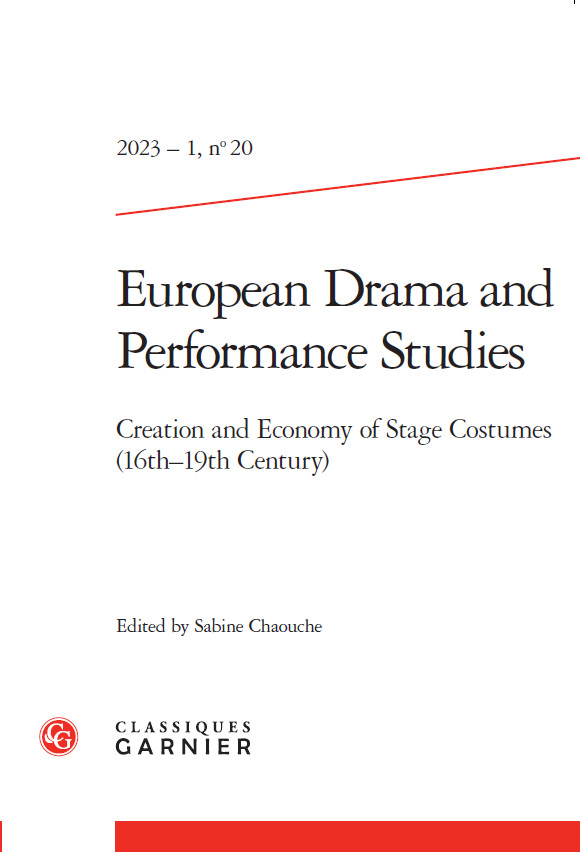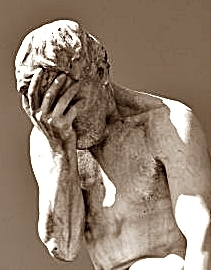
Cette journée d’étude vise à réunir les doctorants et jeunes docteurs travaillant sur la tragédie de l’humanisme aux Lumières. Le thème retenu permettra d’explorer une notion problématique mais centrale pour l’étude de la tragédie française à l’époque moderne, c'est-à-dire depuis sa renaissance au XVIème siècle jusqu’à son déclin à la fin du XVIIIème siècle.
En effet, la réflexion critique des XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles sur la tragédie repose sur le concept trouble d’ « effet ». Aristote a cherché à définir les « moyens de produire l’effet propre de la tragédie » (1) . À sa suite, les théoriciens et les dramaturges rappellent sans cesse la nécessité de « faire effet » mais la nature de l’ « effet » en question n’est définie qu’avec difficulté et réticence, alors que le terme lui-même est propice aux glissements de sens. La double acception d’ « impression » et de « conséquence » permet ainsi de passer facilement du registre affectif à celui d’une morale fondée sur l’exemplarité. « L’effet propre de la tragédie » ressemble à un mystère sur lequel se fonde pourtant tout un édifice de contraintes formelles rigoureuses.
• Comment se définit cet effet ? Le couple aristotélicien de terreur et pitié est régulièrement convoqué. Mais sont-ils les seuls effets ? Qu’en est-il de l’admiration ? de la tristesse ? de l’horreur ? Valent-ils pour eux-mêmes ou par rapport à une hypothétique « catharsis » ? L’enjeu affectif se double-t-il d’un enjeu moral ? De plus, avant même de s'intéresser au niveau affectif et moral, on peut rendre compte d'effets subalternes, mais également plus tangibles tels que l'effet d'attente, l’effet d’annonce, l'effet de surprise, etc. On pourra également se demander ce qu’il en est de la question du plaisir, que Marmontel range parmi l’un des « effet[s] que la Tragédie se propose » (2) ou encore s’interroger sur la notion « d’unité d’intérêt » qui, selon Houdar de la Motte, « toute seule pourrait encore produire un grand effet » en tant que « vraie source de l’émotion continue » (3) . Il s’agira donc de rouvrir l’éventail des effets et de repenser leur rapport et leur hiérarchie.
• « Faire effet » et « produire un effet » peuvent également renvoyer à l’enchaînement des événements dans l’intrigue. Corneille justifiait ainsi son choix de s’éloigner de la vérité historique dans Rodogune et de ne pas charger Antiochus d’un parricide :
Cela fait deux effets. La punition de cette impitoyable mère laisse un plus fort exemple puisqu'elle devient un effet de la justice du ciel, et non pas de la vengeance des hommes, d'autre côté, Antiochus ne perd rien de la compassion et de l'amitié qu'on avait pour lui, qui redoublent plutôt qu'elles ne diminuent, et enfin l'action historique s'y trouve conservée malgré ce changement, puisque Cléopâtre périt par le même poison qu'elle présente à Antiochus. (4)
Plus qu’une simple homonymie, y a-t-il un lien entre ces deux emplois ? Quelle est la conséquence de ce choix lexical ?
Qu’implique par ailleurs la récurrence de cette notion ? En quoi cette insistance sur le thème de l’efficacité et de l’effectivité nous renseigne-t-elle sur les catégories de pensée de l’époque moderne et sur leur évolution ?
• Comment s’opère l’articulation entre formes et effets tragiques ? De quelle manière la poursuite des effets tragiques détermine-t-elle – ou est-elle déterminée par – la mise en forme de la tragédie ? Dans quelle mesure l’invention de nouvelles formes tragiques entraîne-t-elle la promotion de nouveaux effets ?
Le choix d’une périodisation longue (qui dépasse les bornes traditionnelles du « classicisme ») nous permettra de mieux saisir l’évolution des rapports entre discours théorique et pratique et de leurs conditions et lieux de production. Il devrait également faire apparaître des éléments d’historicisation de la sensibilité et de la morale.
Propositions de communication (300 mots maximum) à envoyer avant le 3 juin 2012 à effet.tragedie@gmail.com, accompagnées d’un bref CV.
Notes:
(1) La Poétique, R. Dupont-Roc et J. Lallot éd., Seuil, 1980, 13, 52 b 28
(2) Jean-François Marmontel, Poétique françoise, tome second, Paris, Lesclapart, 1763, p. 99
(3) Antoine Houdar de la Motte, « Premier discours sur la tragédie à l’occasion des Macchabées », in Discours de la tragédie à l’occasion des Macchabées, Paris, Prault l’aîné, 1754, p. 38
(4) Trois discours sur le poème dramatique, « Discours de la tragédie » (1660), M. Escola et B. Louvat éd., Garnier-Flammarion, 1999, p. 117
Source: Jean-Noël Laurenti.
En effet, la réflexion critique des XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles sur la tragédie repose sur le concept trouble d’ « effet ». Aristote a cherché à définir les « moyens de produire l’effet propre de la tragédie » (1) . À sa suite, les théoriciens et les dramaturges rappellent sans cesse la nécessité de « faire effet » mais la nature de l’ « effet » en question n’est définie qu’avec difficulté et réticence, alors que le terme lui-même est propice aux glissements de sens. La double acception d’ « impression » et de « conséquence » permet ainsi de passer facilement du registre affectif à celui d’une morale fondée sur l’exemplarité. « L’effet propre de la tragédie » ressemble à un mystère sur lequel se fonde pourtant tout un édifice de contraintes formelles rigoureuses.
• Comment se définit cet effet ? Le couple aristotélicien de terreur et pitié est régulièrement convoqué. Mais sont-ils les seuls effets ? Qu’en est-il de l’admiration ? de la tristesse ? de l’horreur ? Valent-ils pour eux-mêmes ou par rapport à une hypothétique « catharsis » ? L’enjeu affectif se double-t-il d’un enjeu moral ? De plus, avant même de s'intéresser au niveau affectif et moral, on peut rendre compte d'effets subalternes, mais également plus tangibles tels que l'effet d'attente, l’effet d’annonce, l'effet de surprise, etc. On pourra également se demander ce qu’il en est de la question du plaisir, que Marmontel range parmi l’un des « effet[s] que la Tragédie se propose » (2) ou encore s’interroger sur la notion « d’unité d’intérêt » qui, selon Houdar de la Motte, « toute seule pourrait encore produire un grand effet » en tant que « vraie source de l’émotion continue » (3) . Il s’agira donc de rouvrir l’éventail des effets et de repenser leur rapport et leur hiérarchie.
• « Faire effet » et « produire un effet » peuvent également renvoyer à l’enchaînement des événements dans l’intrigue. Corneille justifiait ainsi son choix de s’éloigner de la vérité historique dans Rodogune et de ne pas charger Antiochus d’un parricide :
Cela fait deux effets. La punition de cette impitoyable mère laisse un plus fort exemple puisqu'elle devient un effet de la justice du ciel, et non pas de la vengeance des hommes, d'autre côté, Antiochus ne perd rien de la compassion et de l'amitié qu'on avait pour lui, qui redoublent plutôt qu'elles ne diminuent, et enfin l'action historique s'y trouve conservée malgré ce changement, puisque Cléopâtre périt par le même poison qu'elle présente à Antiochus. (4)
Plus qu’une simple homonymie, y a-t-il un lien entre ces deux emplois ? Quelle est la conséquence de ce choix lexical ?
Qu’implique par ailleurs la récurrence de cette notion ? En quoi cette insistance sur le thème de l’efficacité et de l’effectivité nous renseigne-t-elle sur les catégories de pensée de l’époque moderne et sur leur évolution ?
• Comment s’opère l’articulation entre formes et effets tragiques ? De quelle manière la poursuite des effets tragiques détermine-t-elle – ou est-elle déterminée par – la mise en forme de la tragédie ? Dans quelle mesure l’invention de nouvelles formes tragiques entraîne-t-elle la promotion de nouveaux effets ?
Le choix d’une périodisation longue (qui dépasse les bornes traditionnelles du « classicisme ») nous permettra de mieux saisir l’évolution des rapports entre discours théorique et pratique et de leurs conditions et lieux de production. Il devrait également faire apparaître des éléments d’historicisation de la sensibilité et de la morale.
Propositions de communication (300 mots maximum) à envoyer avant le 3 juin 2012 à effet.tragedie@gmail.com, accompagnées d’un bref CV.
Notes:
(1) La Poétique, R. Dupont-Roc et J. Lallot éd., Seuil, 1980, 13, 52 b 28
(2) Jean-François Marmontel, Poétique françoise, tome second, Paris, Lesclapart, 1763, p. 99
(3) Antoine Houdar de la Motte, « Premier discours sur la tragédie à l’occasion des Macchabées », in Discours de la tragédie à l’occasion des Macchabées, Paris, Prault l’aîné, 1754, p. 38
(4) Trois discours sur le poème dramatique, « Discours de la tragédie » (1660), M. Escola et B. Louvat éd., Garnier-Flammarion, 1999, p. 117
Source: Jean-Noël Laurenti.