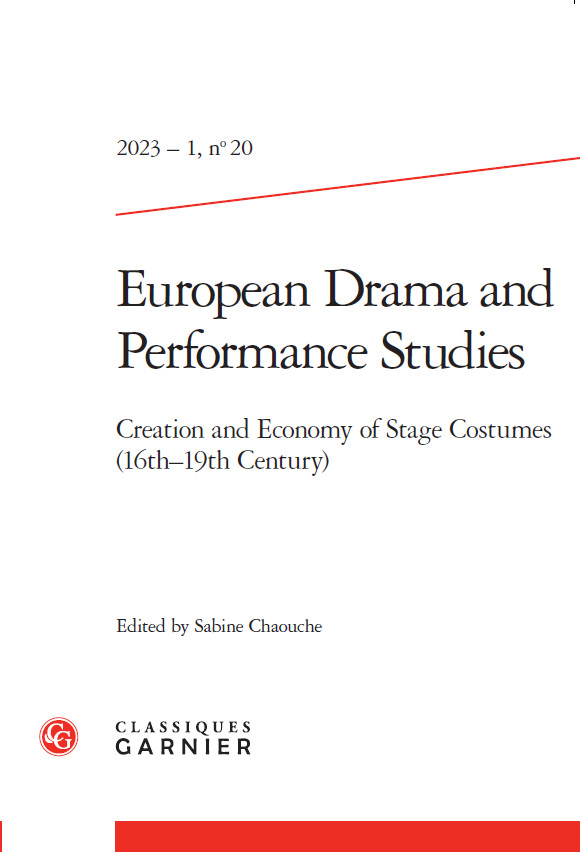Après Colombe qui a fait un triomphe en 1996 et 2010, Le Nombril est à l’affiche de la Comédie des Champs-Elysées. Ce n’est certainement pas la meilleure pièce de l’auteur, mais c’est son testament (1981), une comédie allègre (classée dans les « farceuses) en forme de mise en abyme sur un boulevardier qui cherche à écrire une nouvelle pièce après Corneille, Beckett et Ionesco. Très influencée par Molière, c’est un défilé ininterrompu de fâcheux, dont l’ombre de la Camarde n’est pas la moindre. Les thèmes traditionnels du théâtre comique sont ainsi passés en revue : mariage et cocuage, maladie et médecine, famille et amitié, argent surtout.
Le décor un peu décalé (de Mathieu Lorry-Dupuy) signale l’ironie du propos malgré le très grand classicisme de la mise en scène de Michel Fagadau (mort au début des répétitions). Les costumes (de Pascale Bordet) sont séduisants en diable, tout en froufrou New Look et en borsalinos élégants. Sauf le piteux pyjama de Francis Perrin, bien sûr, qui claudique misérablement de la table à la chaise en passant par le canapé-lit (et retours), incessamment impatienté par son pied attaqué par la goutte et emmailloté dans un pansement démesuré, alors que, fumeur invétéré, il devrait plutôt partir du poumon…
La salle est clairsemée, mais le public ne boude pas son plaisir parce que le texte est construit comme un pièce de boulevard qui loucherait du côté de l’absurde. Les jeux de mots et mots d’auteur fusent (avec une prédilection marquée pour La Rochefoucault et Molière), tellement au second degré qu’on devine parfois la réplique à venir et qu’on jouit de la situation de convention. Le tout est enlevé et désopilant dans la satire. Le médecin de service, à l’avant-scène gauche, se tordait de rire devant les déboires de son homologue fictif (Jean-Paul Bordes), martyrisé par son insupportable patient : « Vous oubliez que je suis un grand médecin ! – Et moi un grand malade !!! » Quand au Déménageur, il venge tous ceux de sa condition et est parfaitement irrésistible, à apporter des cartons pleins d’ennuis au dramaturge en mal d’inspiration.
Anouilh s’offre en effet d’égratigner pêle-mêle les mises en scènes modernes (une Phèdre « horizontale » jouée couchée), l’hypocrisie bourgeoise, le théâtre de Sartre et les faux-semblants familiaux (tous y passent de la vieille épouse intéressée à la jeune maîtresse-actrice ratée, en passant par le gendre coincé et les filles volages).
Le finale est réjouissant, qui reprend le fil tissé tout au long du texte de la rivalité entre théâtre et roman (avec en particulier un éloge de la réplique qui dame le pion à Proust) et qui voit l’Auteur et son ami d’enfance s’écharper pour affirmer à qui mieux mieux la supériorité de leur genre préféré.
Noémie Courtès
Paris, Comédie des Champs-Elysées, jusqu’au 12 juin.
Le décor un peu décalé (de Mathieu Lorry-Dupuy) signale l’ironie du propos malgré le très grand classicisme de la mise en scène de Michel Fagadau (mort au début des répétitions). Les costumes (de Pascale Bordet) sont séduisants en diable, tout en froufrou New Look et en borsalinos élégants. Sauf le piteux pyjama de Francis Perrin, bien sûr, qui claudique misérablement de la table à la chaise en passant par le canapé-lit (et retours), incessamment impatienté par son pied attaqué par la goutte et emmailloté dans un pansement démesuré, alors que, fumeur invétéré, il devrait plutôt partir du poumon…
La salle est clairsemée, mais le public ne boude pas son plaisir parce que le texte est construit comme un pièce de boulevard qui loucherait du côté de l’absurde. Les jeux de mots et mots d’auteur fusent (avec une prédilection marquée pour La Rochefoucault et Molière), tellement au second degré qu’on devine parfois la réplique à venir et qu’on jouit de la situation de convention. Le tout est enlevé et désopilant dans la satire. Le médecin de service, à l’avant-scène gauche, se tordait de rire devant les déboires de son homologue fictif (Jean-Paul Bordes), martyrisé par son insupportable patient : « Vous oubliez que je suis un grand médecin ! – Et moi un grand malade !!! » Quand au Déménageur, il venge tous ceux de sa condition et est parfaitement irrésistible, à apporter des cartons pleins d’ennuis au dramaturge en mal d’inspiration.
Anouilh s’offre en effet d’égratigner pêle-mêle les mises en scènes modernes (une Phèdre « horizontale » jouée couchée), l’hypocrisie bourgeoise, le théâtre de Sartre et les faux-semblants familiaux (tous y passent de la vieille épouse intéressée à la jeune maîtresse-actrice ratée, en passant par le gendre coincé et les filles volages).
Le finale est réjouissant, qui reprend le fil tissé tout au long du texte de la rivalité entre théâtre et roman (avec en particulier un éloge de la réplique qui dame le pion à Proust) et qui voit l’Auteur et son ami d’enfance s’écharper pour affirmer à qui mieux mieux la supériorité de leur genre préféré.
Noémie Courtès
Paris, Comédie des Champs-Elysées, jusqu’au 12 juin.