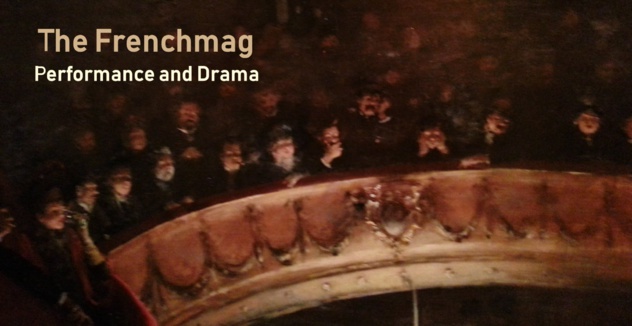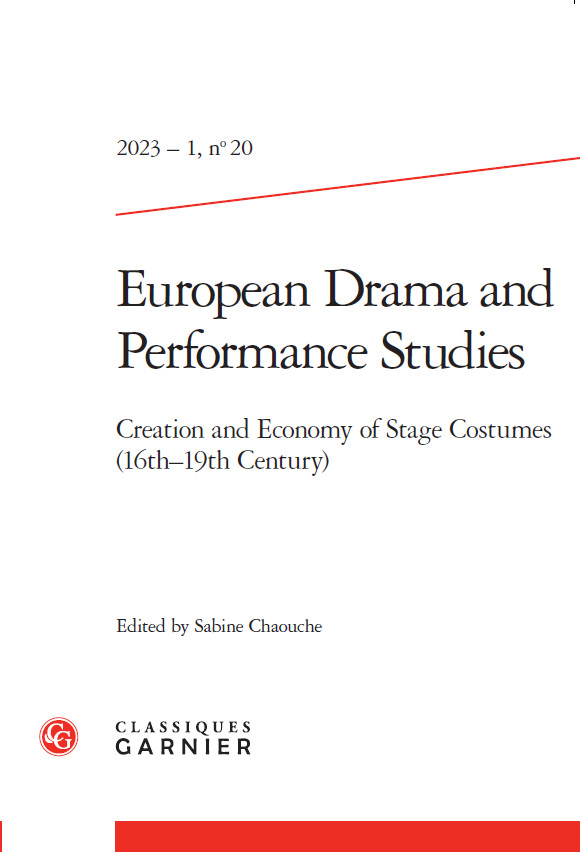Georges Braque, L’oiseau noir et l’oiseau blanc,1960, Huile sur toile, 134 x 167,5 cm, Paris © Leiris SAS Paris © Adagp, Paris 2013 - See more at: http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/georges-braque#sthash.lcmQ31vk.dpuf
« Braque le patron » pour Paulhan ; Braque « le plus grand des peintres vivants de ce monde » pour Nicolas de Staël. Mais Braque aussi le mal-aimé après sa mort et qui, après des années de quasi purgatoire, ce qu’avait prédit Reverdy, retrouve enfin sa place. Non point qu’il eût totalement disparu, mais la dernière rétrospective, celle de l’Orangerie, date de 1973, célébration dix ans après la mort du peintre. Entre 1973 et aujourd’hui, hormis l’importante exposition de Centre Pompidou de 1982, Braque a été davantage présent dans les musées et galeries étrangers que français. La rétrospective du Grand Palais, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la disparition du « patron », est envisagée de façon fort différente de celle de l’Orangerie. 136 œuvres étaient présentées en 1973 ; aujourd’hui, ce sont 238 œuvres qui sont offertes au visiteur. La rétrospective de 1973 commençait avec les années havraises et anversoises. Celle du Grand Palais s’ouvre sur la période fauve, avec les paysages de l’Estaque, un choix de Brigitte Leal, commissaire de l’exposition, parfaitement justifié, puisque c’est avec la découverte de Cézanne, de Matisse et Derain que Braque entre vraiment en peinture. L’itinéraire de l’exposition est chronologique et c’est heureux, car cela permet de saisir pleinement les révolutions « braquiennes », de la période fauve (1905-1906) au temps des oiseaux (1954-1962) et de percevoir comment certaines œuvres portent en elles le passage à une étape nouvelle dans la création de l’artiste. Trois salles sont consacrées aux phases successives de la période cubiste (de son invention au cubisme synthétique, en mettant en relief le temps du cubisme analytique et celui des papiers collés) avec l’effacement puis le retour flamboyant de la couleur. Deux salles présentent les natures mortes, celles des années 1919-1929, encore marquées par la période du cubisme synthétique dans l’une ; celles des années 1932-1939, qui voisinent avec des intérieurs et des figures, beaucoup plus décoratives et ornementées. Entre ces deux périodes une salle offre Nus et Canéphores des années 1922-1930. Une salle est consacrée aux eaux-fortes destinées à illustrer la Théogonie, commande d’Ambroise Vollard et aux plâtres peints et gravés par Braque sur ce thème. Les années sombres de la guerre, passées à Varengeville, sont marquées par une création elle-même sombre, exprimant le malheur de la guerre (les Poissons noirs ; les Vanitas). Viennent les années d’après-guerre et les salles successivement consacrées aux Billards, aux Paysages, peintures panoramiques à la matière puissante, épaisse, aux Ateliers et enfin aux Oiseaux, thème annoncé dans les Ateliers V, VI et VIII et qui témoignent de l’immense capacité de Braque à aller d’une forme à l’autre, du figuratif à l’abstrait. La relation aux poètes, Apollinaire (qui présenta Braque à Picasso), Reverdy, Char, celle aux galeristes et marchands, Kahnweiler, les frères Léonce et Paul Rosenberg, à Jean Paulhan est évoquée tout au long du parcours dans des cabinets thématiques.
L’exposition est accompagnée d’un catalogue dont la qualité esthétique et scientifique en fait un instrument de travail plus qu’utile. Dirigé par Brigitte Léal, il comprend une douzaine d’essais dus à des spécialistes, traitant soit des diverses périodes de la création soit des rapports avec les poètes, soit encore de la réception de Braque aux Etats-Unis. Sur ce dernier aspect, on peut regretter que l’étude n’ait pas porté sur le monde anglo-saxon, quand on sait la fortune de Braque outre Manche (une trentaine d’expositions dont une quinzaine personnelles).
Il faut souligner combien il est heureux que Braque soit à nouveau donné à voir ; pour beaucoup, cette exposition sera une découverte de cet artiste, non pas oublié, mais laissé pendant trop longtemps dans l’ombre de Picasso, son compagnon de route en cubisme avant que la rupture entre les deux hommes n’intervienne.
Du 18 septembre 2013 au 6 janvier 2014, musée du Grand Palais, ouvert du mercredi au samedi de 10hh à 22h, le lundi et le dimanche de 10h à 20h ; du 19 octobre au 2 novembre tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 22h et du 21 décembre au 4 janvier, tous les jours sauf le mardi et le 25 décembre) de 9h à 22h. Fermeture le mardi et le 25 décembre.
Michel Rapoport, professeur honoraire d’histoire, université Paris Est Créteil
L’exposition est accompagnée d’un catalogue dont la qualité esthétique et scientifique en fait un instrument de travail plus qu’utile. Dirigé par Brigitte Léal, il comprend une douzaine d’essais dus à des spécialistes, traitant soit des diverses périodes de la création soit des rapports avec les poètes, soit encore de la réception de Braque aux Etats-Unis. Sur ce dernier aspect, on peut regretter que l’étude n’ait pas porté sur le monde anglo-saxon, quand on sait la fortune de Braque outre Manche (une trentaine d’expositions dont une quinzaine personnelles).
Il faut souligner combien il est heureux que Braque soit à nouveau donné à voir ; pour beaucoup, cette exposition sera une découverte de cet artiste, non pas oublié, mais laissé pendant trop longtemps dans l’ombre de Picasso, son compagnon de route en cubisme avant que la rupture entre les deux hommes n’intervienne.
Du 18 septembre 2013 au 6 janvier 2014, musée du Grand Palais, ouvert du mercredi au samedi de 10hh à 22h, le lundi et le dimanche de 10h à 20h ; du 19 octobre au 2 novembre tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 22h et du 21 décembre au 4 janvier, tous les jours sauf le mardi et le 25 décembre) de 9h à 22h. Fermeture le mardi et le 25 décembre.
Michel Rapoport, professeur honoraire d’histoire, université Paris Est Créteil