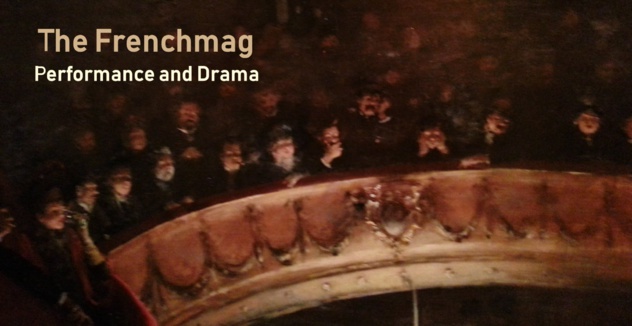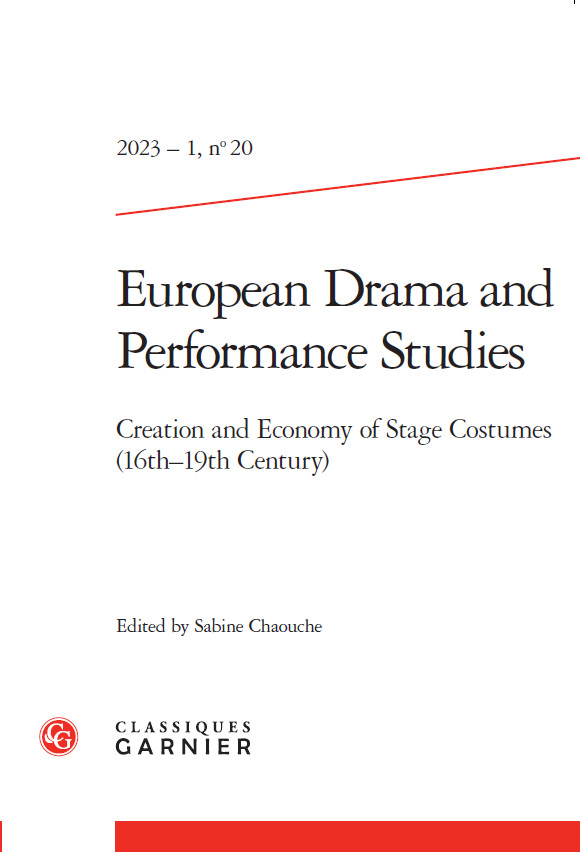Artemisia Gentileschi Danaë c.1612 Huile sur cuivre 41,3 x 52,7 cm Saint Louis, The Saint Louis Art Museum © Saint Louis, The Saint Louis Art Museum
Pas de quoi crier au chef-d’œuvre, surtout quand on n’est pas sensible à la grande peinture religieuse et allégorique du Grand Siècle. Mais pas de quoi non plus décrier cette peinture, surtout lorsqu’on peut – comme ici – comparer les toiles attribuées avec certitude à celles des mains de son atelier ou de certains de ses concurrents (on finit pas ne plus regretter les fonds inexistants des « originaux » lorsqu’on voit ce qu’ils deviennent au fil des copies, avec leurs architectures fades et compliquées !).
Cependant, le propos des commissaires est ambigu : il veut à la fois séduire, en soulignant le glamour de l’artiste (le sous-titre ronflant de l’exposition est « Pouvoir, gloire et passions d’une femme peintre »), son côté sulfureux (il paraît difficile de ne pas citer le viol dont elle a été victime) ; mais il se veut également extrêmement documenté et sérieux dans l’accompagnement pédagogique des spectateurs qui ont perdu la plupart des codes à l’œuvre dans les quelques vingt-cinq tableaux présentés. Le livret distribué à l’entrée et les nombreux panneaux explicatifs en font foi.
C’est évidemment ce second aspect qui est le plus remarquable. Artemisia Gentileschi (1593-1654 ?) est replacée dans son contexte pictural et social grâce à plusieurs œuvres de son père (Orazio, auteur d’un superbe Saint Jérôme) et à la comparaison avec ses contemporains ou prédécesseurs immédiats, au premier rang desquels, Le Caravage (1571-1610). La majeure partie de l’exposition (au rez-de-chaussée) met volontairement en relief sa période la plus féconde, la fin de sa carrière, lorsqu’elle jouit à Naples d’une renommée internationale, entre 1630 et 1654. Le premier étage revenant sur ses premières années, depuis son admission par la fameuse Accademia del Disegno de Florence en 1616, mais aussi sur le travail de son atelier et ses collaborations prestigieuses, avec Vouet par exemple lorsqu’ils se côtoient à Rome.
Sont ainsi battues en brèche certains clichés, notamment sur l’origine de ses sujets macabres (trois versions de Judith et Holopherne sanglantes, sans compter un Yaël et Sesera sur un thème moins connu mais voisin), qui relèvent peut-être de l’imaginaire du viol mais ressortissent surtout aux thématiques en vogue pendant la Contre-Réforme, de même que les Vierges à l’enfant multipliées à l’envi. L’originalité de l’exposition est aussi de montrer des tableaux beaucoup moins connus : portraits (en particulier le portrait d’une dame vers 1620, dont les broderies de la robe sont magnifiquement rendues) et allégories souvent très réussies lorsqu’elles consacrent les arts.
Artemisia Gentileschi est également envisagée comme femme indépendante grâce à cinq lettres d’amour qui permettront peut-être de vérifier certaines attributions, mais éclairent déjà quelques points de sa façon d’envisager son travail. Car le principal intérêt de l’exposition, à lire entre les lignes, est de dévoiler les difficultés de l’histoire de l’art qui décripte ces années-là : chronologie des versions successives, problèmes d’attributions, disparition et réapparition des œuvres (un David d’Orazio Gentileschi, précieux car peint sur lapis-lazuli, est présenté pour la première fois, identifié quelques semaines avant l’exposition), influences croisées (le Portrait d’un gentilhomme au chien de Vouet éclipse quelque peu par son brillant le Gonfalonier de Gentileschi, mais Artemisia résiste bien face à un Mellan sinistre par ailleurs), etc.
Cette exposition vaut donc bien le battage médiatique dont elle a fait l’objet, même si cette peinture n’est pas exaltante (les cadrages sont très serrés, les fonds sombres, les anatomies laissent souvent à désirer – il est alors d’autant plus ironique que la présentation se passe en regard des sculptures de Maillol qui relativisent leur silhouette). Ce n’est pas si souvent qu’une femme peintre est à l’honneur (combien de monographies sur les rares qui se sont distinguées dans les siècles passés ? quasiment rien sur Artémisia, ou sur Mme Vigée Lebrun et leurs homologues), alors, puisque le propos est intéressant, autant ne pas bouder la manifestation.
Paris, Musée Maillol, jusqu’au 15 juillet 2012.
Compte rendu par Noémie Courtès.
Documents en ligne sur le site du musée : http://www.museemaillol.com/exposition/artemisia/la-presse/#
Cependant, le propos des commissaires est ambigu : il veut à la fois séduire, en soulignant le glamour de l’artiste (le sous-titre ronflant de l’exposition est « Pouvoir, gloire et passions d’une femme peintre »), son côté sulfureux (il paraît difficile de ne pas citer le viol dont elle a été victime) ; mais il se veut également extrêmement documenté et sérieux dans l’accompagnement pédagogique des spectateurs qui ont perdu la plupart des codes à l’œuvre dans les quelques vingt-cinq tableaux présentés. Le livret distribué à l’entrée et les nombreux panneaux explicatifs en font foi.
C’est évidemment ce second aspect qui est le plus remarquable. Artemisia Gentileschi (1593-1654 ?) est replacée dans son contexte pictural et social grâce à plusieurs œuvres de son père (Orazio, auteur d’un superbe Saint Jérôme) et à la comparaison avec ses contemporains ou prédécesseurs immédiats, au premier rang desquels, Le Caravage (1571-1610). La majeure partie de l’exposition (au rez-de-chaussée) met volontairement en relief sa période la plus féconde, la fin de sa carrière, lorsqu’elle jouit à Naples d’une renommée internationale, entre 1630 et 1654. Le premier étage revenant sur ses premières années, depuis son admission par la fameuse Accademia del Disegno de Florence en 1616, mais aussi sur le travail de son atelier et ses collaborations prestigieuses, avec Vouet par exemple lorsqu’ils se côtoient à Rome.
Sont ainsi battues en brèche certains clichés, notamment sur l’origine de ses sujets macabres (trois versions de Judith et Holopherne sanglantes, sans compter un Yaël et Sesera sur un thème moins connu mais voisin), qui relèvent peut-être de l’imaginaire du viol mais ressortissent surtout aux thématiques en vogue pendant la Contre-Réforme, de même que les Vierges à l’enfant multipliées à l’envi. L’originalité de l’exposition est aussi de montrer des tableaux beaucoup moins connus : portraits (en particulier le portrait d’une dame vers 1620, dont les broderies de la robe sont magnifiquement rendues) et allégories souvent très réussies lorsqu’elles consacrent les arts.
Artemisia Gentileschi est également envisagée comme femme indépendante grâce à cinq lettres d’amour qui permettront peut-être de vérifier certaines attributions, mais éclairent déjà quelques points de sa façon d’envisager son travail. Car le principal intérêt de l’exposition, à lire entre les lignes, est de dévoiler les difficultés de l’histoire de l’art qui décripte ces années-là : chronologie des versions successives, problèmes d’attributions, disparition et réapparition des œuvres (un David d’Orazio Gentileschi, précieux car peint sur lapis-lazuli, est présenté pour la première fois, identifié quelques semaines avant l’exposition), influences croisées (le Portrait d’un gentilhomme au chien de Vouet éclipse quelque peu par son brillant le Gonfalonier de Gentileschi, mais Artemisia résiste bien face à un Mellan sinistre par ailleurs), etc.
Cette exposition vaut donc bien le battage médiatique dont elle a fait l’objet, même si cette peinture n’est pas exaltante (les cadrages sont très serrés, les fonds sombres, les anatomies laissent souvent à désirer – il est alors d’autant plus ironique que la présentation se passe en regard des sculptures de Maillol qui relativisent leur silhouette). Ce n’est pas si souvent qu’une femme peintre est à l’honneur (combien de monographies sur les rares qui se sont distinguées dans les siècles passés ? quasiment rien sur Artémisia, ou sur Mme Vigée Lebrun et leurs homologues), alors, puisque le propos est intéressant, autant ne pas bouder la manifestation.
Paris, Musée Maillol, jusqu’au 15 juillet 2012.
Compte rendu par Noémie Courtès.
Documents en ligne sur le site du musée : http://www.museemaillol.com/exposition/artemisia/la-presse/#

Artemisia Gentileschi Allégorie de la Peinture Huile sur toile 98 x 74,5 cm Rome, Galleria Nazionale di Palazzo Barberini © Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Roma

Artemisia Gentileschi Allegorie de la Renommée c. 1630-35 Huile sur toile 57,5 x 51,5 x 2 cm Londres-Milan, Robilant+Voena © Manusardi Art Photo Studio, Milano